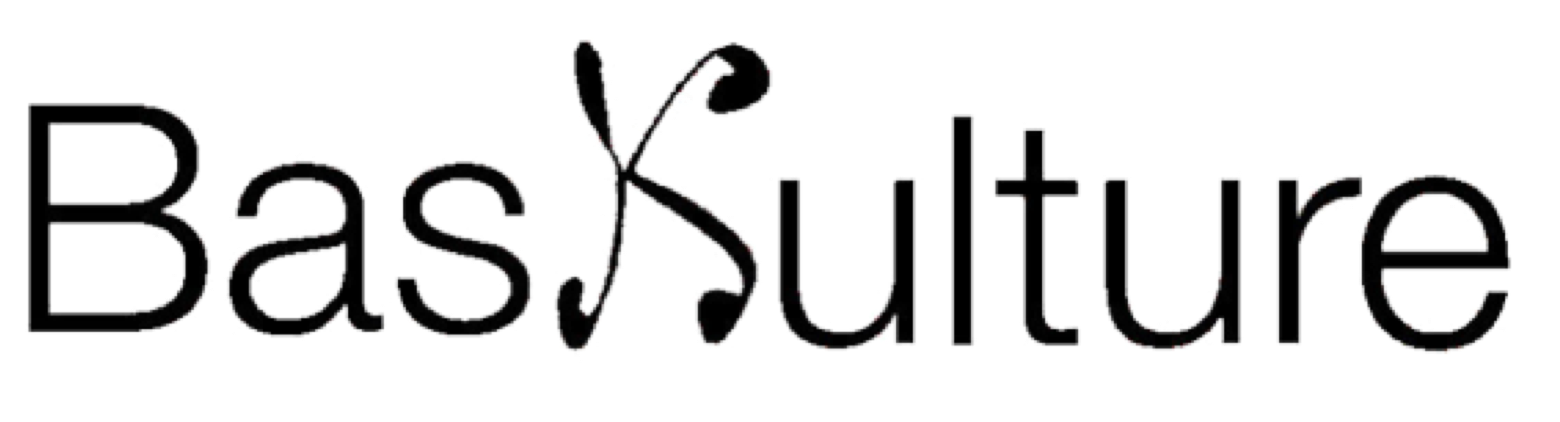« Une affaire de famille » – Film japonais de Hirokazu Kore-eda – 121’
Dans un super marché japonais, guetté par Osamu (Lily Franky) de jeunes enfants, dont son fils Shota (Jyo Kairi), volent sur les rayonnages quelques objets et friandises. C’est leur mode de vie fait de chapardages, rapines, en marge de la société nippone. Ce petit monde loge dans une maison lilliputienne, à pièce unique, au fond d’un maigre jardin en déshérence. Dans ce cloaque s’entassent la femme d’Osamu, Nobuyo (Ando Sakura), la grande mère Hatsue (Kirin Kiki), sa belle-fille Aki (Mayu Matsuoka). Toute cette phratrie survit tant bien que mal dans cette pièce minuscule en un joyeux désordre.
Un soir, Osamu et Shota ramènent une petite fille, Hojo (Sasaki Miyu), qui était en pleurs sur le balcon de l’appartement de ses parents. L’enfant porte des traces de violence et semble mal nourrie. Le petit groupe l’adopte aussitôt en changeant son prénom : elle s’appellera désormais Yuri. Compatissants, ils la nourrissent. La nuit elle fait pipi au lit… Ses parents biologiques ne semblent pas préoccupés par sa disparition…
Les scènes d’exposition, de développement, se succèdent. Nous comprenons que cette famille en apparence soudée n’a rien de conventionnel : ce n’est pas une famille « naturelle », biologique, mais choisie, peut-être par défaut, par ses protagonistes. Ce qui les agrège, ce n’est pas le sang, mais le rejet de la loi, des conventions, de la morale. Chaque membre a ses petits secrets, sa part d’ombre : Osamu est un fainéant, Nobuyo une chapardeuse, Hatsue une dissimulatrice, Aki une prostituée, etc. Ils ne sont pas fondamentalement affreux, sales, méchants, mais en marge d’une société fermée, hiérarchisée, qui les rejette car ils ne jouent pas le jeu social convenu. C’est une association provisoire de malfaisants au rabais dans une civilisation, la nippone, fort rigide en codes et en signes.
Les gardiens de la loi, de l’ordre, de la morale rôdent, veillent : les fonctionnaires, les enquêteurs, les policiers…
Hirokazu Kore-eda (56 ans) reprend ici un thème qui lui est cher : l’ambivalence de la famille, à la fois destructrice et constructrice. Par le passé il a, à plusieurs reprises, traité ce sujet récurrent dans son œuvre (13 longs métrages à ce jour) : Nobody Knows (2004), Still Walking (2008), Tel père, tel fils (2013), Après la tempête (2016). C’est une forme de cinéma social qui laisse vivre ses personnages librement et qui, de ce fait, nous surprend à tout coup. On le compare souvent, à tort, à Ken Loach, cinéaste anglais, qui propose également un cinéma social, a fort contenu idéologique, dont les personnages sont très typés, comme saturés, aux comportements prévisibles. Ici, rien de tout cela. Ceux-ci semblent avoir leurs propres vérités, vaguer, survivre sur un mode sans déterminisme. Les vrais modèles cinématographiques de Hikazu Kore-eda seraient à chercher du côté des réalisateurs italiens : Federico Fellini, Robert Rossellini, Dino Risi, Mario Monicelli, etc.
Le visionnage du film est étrange : le récit semble par moment comme suspendu dans son déroulé ce qui est contraire aux règles de la fiction cinématographique souvent mécaniste. C’est le résultat de la méthode de fabrication du film qu’a mise au point le réalisateur également scénariste : il tourne les scènes avec son chef opérateur Ryuto Kondo (seul décideur des cadrages), les assemble au fur et à mesure, et modifie le scénario en fonction du résultat du montage. Il y a, de fait, une dialectique fructueuse entre le filmage et le montage qui permet au réalisateur de « raturer », de corriger, les scènes à tourner et de ne se concentrer que sur la direction d’acteurs. Ces derniers sont déstabilisés, toujours en éveil, débarrassés de leurs tics, car la continuité du scénario peut être rompue à tout moment et leur interprétation remise en question.
Cet inconfort, revendiqué par Hirokazu Kore-eda, nourrit le film d’une vibration particulière qui est en adéquation totale avec le propos du film : qui sont réellement ces gens ? La fabrication inédite de ce long métrage (2 heures) favorise l’acquis journalier (filmage/montage) qui prédomine l’inné (le scénario). Le résultat en est une symbiose parfaite de la narration de ce microcosme humain, instable, dans un environnement sociétal ordonné.
Le film réussit à cumuler trois plans en général antithétiques : réaliste dans sa description, poétique dans ses propos, humaniste dans sa conclusion.
Hirokazu Kore-eda a développé son scénario à partir d’un fait divers : la vie d’une famille japonaise d’Osaka. Il l’a détricoté ensuite pour faire apparaître visuellement, émotionnellement, le souffle de la vie, par une maîtrise surprenante de l’espace (la maisonnette, les rues vides, la plage), du temps, alangui au début (séquences d’exposition) puis accéléré au gré des rebondissements de l’histoire.
L’humanité dans sa variété, sa complexité, son ambivalence, perfuse dans ce film attachant qui a, malgré le succès commercial dans son pays, fortement déplu aux autorités politiques : il offre à nos regards étrangers une image non conventionnelle du Japon.
Le film a obtenu la Palme d’Or au dernier Festival de Cannes. Elle est amplement méritée dans une compétition aussi relevée.