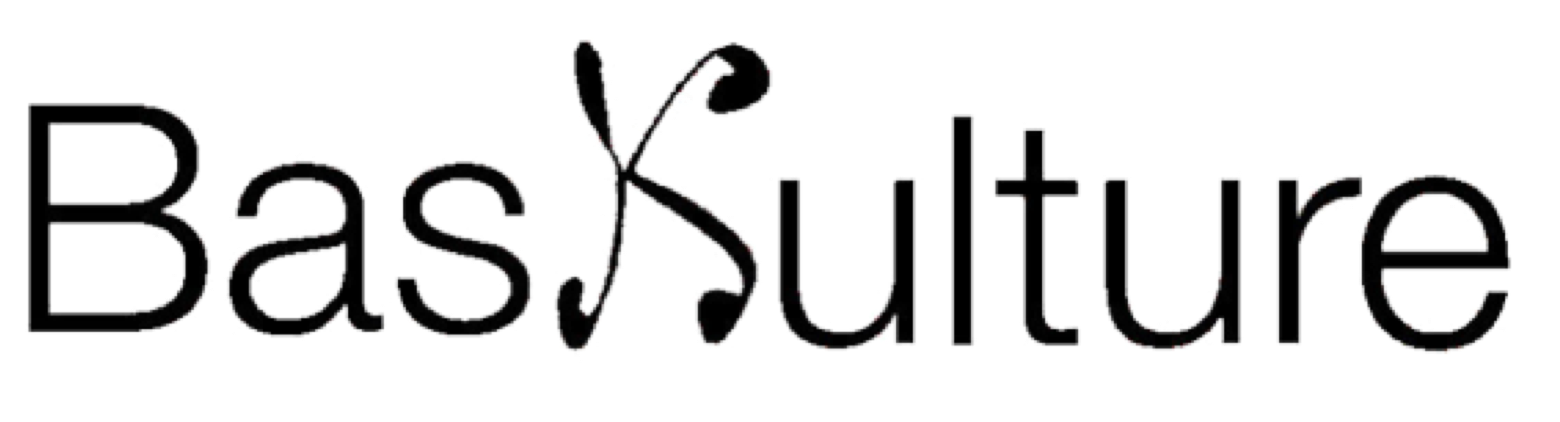En février 1979, l’Iran est devenu une République Islamique à la suite de la prise du pouvoir par l’ayatollah Rouhollah Khomeini, considéré comme le « Guide Suprême » de la religion chiite (dans sa variante iranienne). Le Shah d’Iran, Reza Pahlavi (1919/1980), un dictateur occidentalisé, diminué par une longue maladie, s’est enfui précipitamment avec ses proches et quelques hiérarques de sa cour. Le régime monarchique des Pahlavis (1925/1979), peu soutenu par la majorité du peuple iranien a qui la modernisation à marche forcée du pays ne bénéficiait pas, s’est effondré brutalement. Au régime autoritaire du Shah a succédé une théocratie religieuse non moins autoritaire. Le cinéma iranien, pour une grande part de divertissement fut emporté par la tourmente : fermeture partielle, puis totale des salles obscures (environ 500) ; le cinéma « débauché » n’avait en définitive plus lieu d’exister. Les autorités religieuses considéraient traditionnellement le cinéma, sous influence occidentale, comme « corrupteur », « contraire aux bonnes mœurs ».
En 1984, une nouvelle législation codifie les règles à respecter dans le domaine de la création cinématographique : « Un film doit être utile à la société ; il faut éviter de proférer des blasphèmes contre les religions officielles du pays ; éviter de propager des idéologies subversives », etc. D’autres règles non écrites complètent le corpus d’interdictions en tous genres, morales pour l’essentiel. Cela n’est pas sans rappeler, ironiquement, le fameux code de production dit code Hays que les grandes majors américaines appliquèrent durant plus de 30 ans (1934/1966). Tout en forçant ainsi la production cinématographique iranienne à bannir le « cinéma commercial » à coup d’interdits, dans un même mouvement, le nouveau régime favorisa un cinéma d’auteur qui fait la part belle aux réalisateurs au détriment des producteurs. Ce mouvement acquit sa renommée sous le nom de « nouvelle vague iranienne » à l’instar du « néoréalisme italien » (1943/1955) né au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, ou de la « Nouvelle Vague » française (1959/1969) émergeant au début des années 60, grâce en partie à la révolution technologique (caméra légère, prise de son direct, pellicules plus sensibles, etc.).
La consécration internationale de ce mouvement eut lieu en 1997 quand Le Goût de la cerise d’Abbas Kiarostami (1940/2016) obtint la prestigieuse Palme d’or au Festival de Cannes (Présidente du jury : Isabelle Adjani). Dès lors, la nouvelle génération de cinéastes iraniens, très présente dans les festivals internationaux, rafle les récompenses : Le Lion d’or à la Mostra de Venise pour Le Cercle (2000) de Jafar Panahi ; L’Ours d’or de la Berlinale pour Une séparation (2011) pour Asghar Farhadi, puis pour Taxi Téhéran (2015) pour Jafar Panahi ; la Coquille d’or du Festival de San Sébastian à deux reprises pour Les Tortues volent aussi (2004) et Demi-lune (2006) de Bahman Ghobadi.
Le cinéma iranien, peu ou pas diffusé à l’intérieur du pays (85 millions d’habitants !), rayonne à l’extérieur à travers le système de promotion puissant inhérent aux grands festivals internationaux. C’est un incroyable paradoxe cinématographique !
En 2017, Un homme intègre (118’) de Mohammad Rasoulof, œuvre très critique de la société iranienne sous le joug des mollahs, a été présenté dans la section un Certain regard au Festival de Cannes ou il a remporté le prix. La réponse des autorités iraniennes a été immédiate : confiscation de son passeport, interrogatoire, surveillance, etc. En 2019, il est condamné a un an de prison pour propagande contre le régime. C’est ce réalisateur empêché qui, à 48 ans, se lance dans la fabrication difficile de son huitième long métrage : Le Diable n’existe pas (2h30’).
Dans l’Iran des ayatollahs, la censure cinématographique s’exerce de l’amont (dépôt du scénario pour validation) à l’aval (tournage, projection du film devant un comité ad hoc). Pour échapper à cet étau, le réalisateur également scénariste a eu l’idée d’élaborer quatre histoires sous forme de contes persans pour en faire après montage un long métrage. La raison est simple : la censure religieuse, tatillonne, ne s’intéresse qu’aux longs métrages susceptibles d’être programmés dans le pays et délaisse les moyens et courts métrages réputés moins nocifs.
Le film comporte donc quatre épisodes (Le diable n’existe pas ; Elle a dit : tu peux le faire ; Anniversaire ; Embrasse-moi) avec quatre histoires autour d’un thème central cité par Mahammad Rasoulof dans une interview : « la façon dont on assure la responsabilité de ses actes dans un contexte totalitaire ». Chaque épisode se clôt par une « chute » brutale qui déstabilise le spectateur : c’est une variation sur la responsabilité individuelle (nous ne pouvons en dire plus …). Les mécanismes sociétaux dans un régime totalitaire nous enjoignent de nous conformer à la norme exigée nous délestant ainsi de toute exigence morale personnelle. C’est, succinctement, le concept de la « banalité du mal » décrit par la philosophe Hannah Arendt (1906/1975) dans son ouvrage sur le procès du dirigeant nazi Adolf Eichmann (1961) : Eichmann à Jerusalem – Rapport sur la banalité du mal (1963) qui suscita tant de controverses.
Les quatre histoires sont filmées de façons différentes. Malgré les difficultés de tournage que l’on imagine, Mohammad Rasoulof a pris soin de créer une adéquation entre le style narratif des deux premiers épisodes urbains (images sombres, crayeuses) et des deux suivants dans la nature (images lumineuses, décors naturels magnifiques). Ainsi les deux formes visuelles proposées mêlées à celle de la bande son (des musiques et la chanson Bella ciao, chant de révolte italien des partisans de la Seconde Guerre Mondiale) provoquent sur le spectateur un choc émotionnel inattendu. Mohammad Rasoulof nous capte dans les rets de ses quatre récits dont nous découvrons la complexité image après image …
Le Diable n’existe pas à obtenu l’Ours d’or au Festival de Berlin 2020. Le prix a été remis à ses comédiens en l’absence du réalisateur retenu en Iran. Depuis il est sommé de purger sa peine de prison (1 an !).
Ainsi que nous l’avions recommandé en son temps pour Un homme intègre (2017), son précédent opus, Le Diable n’existe pas est à voir toutes affaires cessantes !