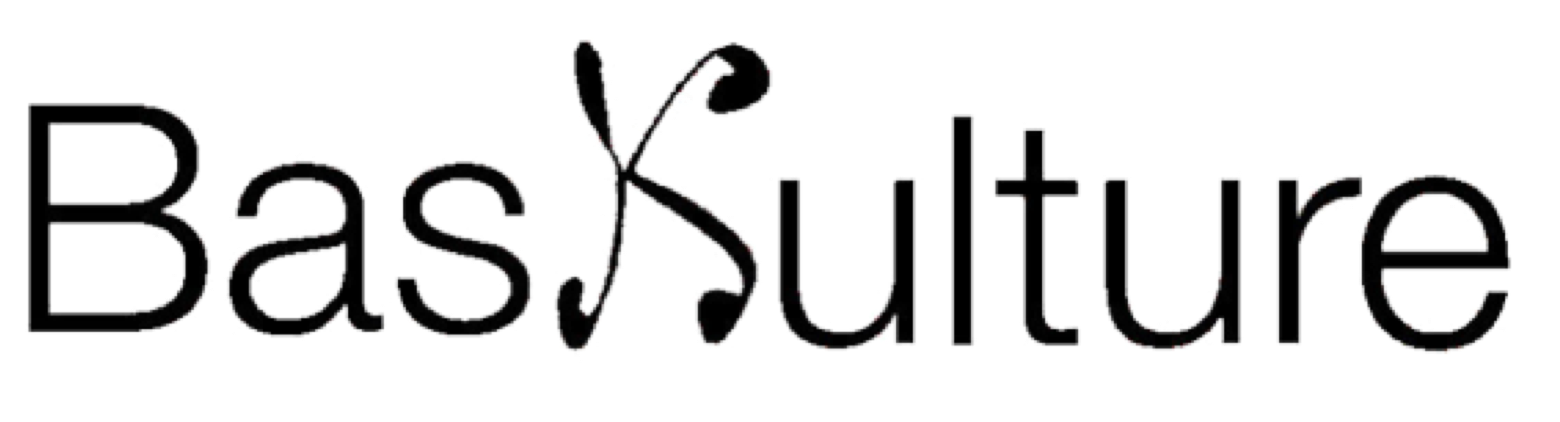Alberto Giacometti, The Final Portrait - Film britannique de Stanley Tucci – 94’
Paris 1964. Alberto Giacometti (Geoffrey Rush) est à l’acmé de sa gloire artistique. Sculpteur, peintre reconnu, admiré pour son œuvre unique, sans concession à la mode du temps, il vit avec sa femme Annette (Sylvie Testut) épousée en 1949, dans une « caverne-atelier » sale, encombrée de sculptures en plâtre au 46 de la rue Hippolyte Maindron (Paris – Montparnasse). Il est instable, tourmenté, agité, fumeur impulsif, grand buveur. Sa vie privée est en capilotade. Il s’échappe de temps à autre de son atelier insalubre avec sa maitresse Caroline (Clémence Poésy), jeune femme de petite vertu. Sur les conseils de Pierre Matisse (James Faulkner), galeriste, marchand de Giacometti et fils d’Henri Matisse, un écrivain américain, James Lord (Armie Hammer), son futur biographe, accepte de poser pour lui. Le talent de portraitiste exigeant qu’il a développé depuis la fin de la seconde guerre mondiale est légendaire : toutes les personnes de son entourage se sont assises sur une vieille chaise et ont patiemment attendu sans bouger, la création du maître: Annette, Diego son frère, sa mère, des amis de passage, des connaissances célèbres ou pas (Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Paul Eluard, George Bataille, etc.).
La pose devait durer un après-midi selon les quelques mots marmonnés par Giacometti. Ce dernier en pleine ébullition créative fait et défait le portrait de sorte que la séance de pose initiale s’étire sur dix-huit autres !
Le cinquième long métrage du metteur en scène américain Stanley Tucci, connu pour sa longue carrière d’acteur dans des films américains, est du genre biopic. C’est un genre a priori facile : filmer la vie d’un personnage célèbre. Les œuvres de ce genre particulier, très prisé des américains, sont dans leur immense majorité décevantes. Les vies - édifiantes ou non - passées au crible de l’écriture cinématographique sont d’un ennui mortel, car le vécu de l’impétrant se déroule d’une manière mécanique qui apparaît comme une suite logique de péripéties.
Dans la vie courante, comme dans le 7ème Art, tout ce qui est prévisible est ennuyeux !
Stanley Tucci, également scénariste de son dernier opus, a eu l’intelligence scénaristique de concentrer son récit sur quelques jours autour du même rituel : le portraituré s’assoit sur la chaise rapiécée, le peintre se place face à lui devant sa toile, puis furieux, jurant s’interrompt en maudissant son travail qu’il détruit méthodiquement à coup de brosses rageuses. La répétition de ce rituel avec quelques variantes et les brusques échappées hors « atelier-caserne » produit une « cadence » au film. Il est en quelque sorte ramassé sur lui-même et nous épargne les « scènes faibles » si courantes dans ce genre cinématographique.
Pour ceux qui n’ont pas lu les biographies qui lui ont été consacrées (Yves Bonnefoy – Flammarion 1991. Véronique Wiesinger – Gallimard Découverte – 2007, etc.) ou visité une des nombreuses expositions consacrées à cet artiste étonnant, intemporel (ses œuvres ont radicalement muté entre l’avant-guerre et l’après-guerre), ce film, en dépit d’une forme certes appliquée, avec de bons acteurs, des décors soignées (reconstitution de l’atelier « gourbi »), est une ouverture à la connaissance d’un artiste majeur du XXème siècle.
Jean-Louis Requena