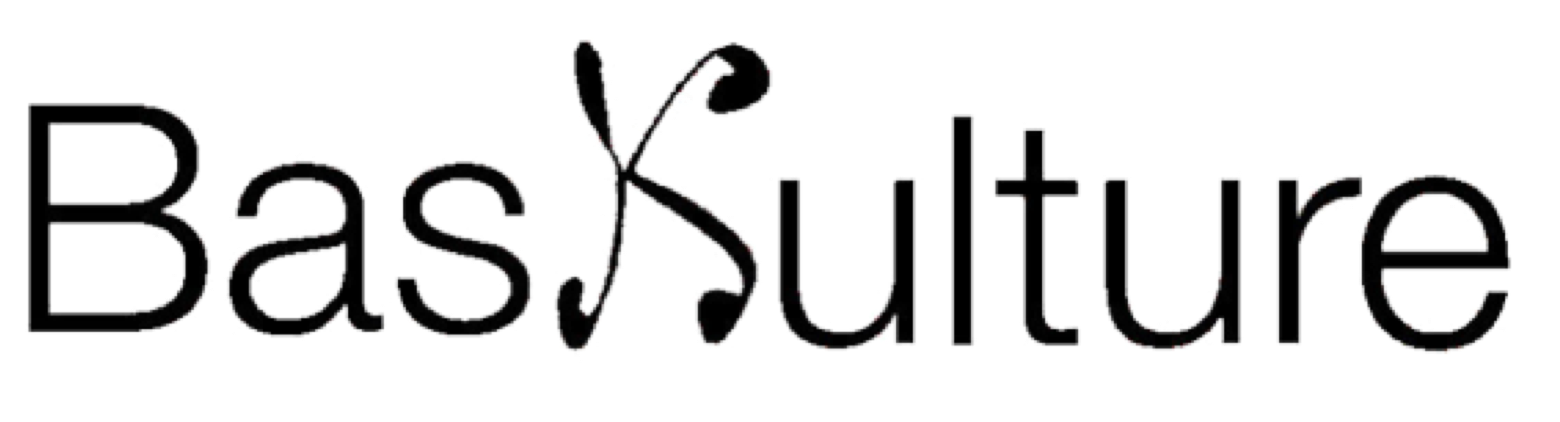« La Via Crucis est la prière de ceux qui bougent. »
Chemin de Croix au Colisée,
Méditations du Pape François, du Vendredi Saint, 18 avril 2025.
« Pour trouver Dieu il faut être heureux
car ceux qui par détresse l’inventent
vont trop vite et cherchent trop peu
l’intimité de son absence ardente ».
Rainer Maria Rilke, À Madame la Baronne Renée de Brimont.
Le visage et le glaive
« C’est chose tendre que la vie et aysée à troubler . »
Michel de Montaigne, Essais, III, 9.
Il est d’impérieuses aimantes dont l’amour dépasse l’aimé : il n’a pas besoin de réponse, parce qu’il contient l’appel et la réponse ; il s’exauce lui-même. Mais l’amant, lui, aurait dû s’incliner devant elle, dans toute sa magnificence tendre, et ce qu’elle lui soufflait, l’écrire à deux mains, comme Jean à Patmos, à genoux, dans la lumière terrible de la révélation.
Il n’y avait là aucun choix possible : sa voix — cette voix venue d’elle — “remplissait la fonction des anges” (Rilke), qui venait pour l’envelopper, le déchirer, l’entraîner vers l’éternel. C’était là le char flamboyant de sa montée. Et lui n’a pas su le voir.
Pardonnez-moi de trop vous aimer. Votre regard, tel le duvet d’un nid abandonné, accrochait la lumière éternelle. Deux ans ont passé, et il ne s’efface pas. Comment le pourrait-il ? Il était une signature divine sur le « papier-monnaie du temps » (Bobin), un jaillissement de l’absolu sourire de Dieu. Ce sourire, nul ne pouvait le voir sans en mourir :
« Mais elle, qui devinait mon désir,
dit en souriant avec tant de gaieté
que Dieu semblait sur sa face en jouir. (1) »
Votre sourire m’a arraché le cœur, encore vivant. Vos yeux, impérieuses lames de lumière, l’ont fendu d’un seul éclat. Ces yeux n’appartiennent pas à la chair : ils relèvent du ciel. Et dans ce ciel, j’ai entendu non pas une parole, mais un glaive pur, éclatant, qu’aucune tendresse — pas même la vôtre — n’aurait pu émousser :
« Un jour viendra sans moi… Viendra ce moment où vous tendrez la main, et je ne la prendrai plus. »


Une parole d’amour, plus tranchante que l’épée, douce comme un linge posé sur une plaie vive, et pourtant déposée dans votre regard comme une sentence contre laquelle nul ne peut plaider.
Comment survivre au jour qu’elle annonçait — et qui est venu ? Depuis, rien ne tient debout. Je suis un homme disloqué. Mon cœur bat, mais au bout de mes bras. Mes jambes me portent, mais je me tiens à leur côté. Ou l’inverse : peut-être est-ce moi, l’ombre de mon propre corps.
Je marche, ombre de moi-même, mon cœur saignant au bout de mes bras. Comme un frère jumeau devenu fantôme. Comme une âme évacuée de sa chair.
Je marche à côté de moi
« Je marche à côté de moi en joie
J’entends mon pas en joie qui marche à côté de moi
Mais je ne puis changer de place sur le trottoir
Je ne puis mettre mes pieds dans ces pas-là
et dire voilà c’est moi (2). »
Quel amant suis-je, à penser tant à ma peine et si peu à la sienne ? Elle le savait. Elle savait que, si j’avais compris — vraiment compris — que son bonheur exigeait mon oubli, que sa joie demandait ma disparition, j’aurais dit oui. Sans hésiter. Sans retour. Oui. Allez. Vivez. Soyez heureuse. Même sans moi. Surtout sans moi, si c’est cela, votre lumière. J’aurais dû le dire. J’aurais dû le faire. Tout homme aimant vraiment l’aurait fait. Mais je me suis accroché à ma douleur comme à un droit. Je n’ai pas su m’effacer. Je n’ai pas su aimer jusqu’au bout.
Aimer pour elle seule, même contre moi-même. Si, pour qu’elle respire, pour qu’elle trouve sa lumière, sa justesse, sa liberté, il fallait qu’elle m’oublie, qu’elle efface jusqu’à la trace de mon pas dans sa mémoire, alors, Seigneur, qu’il en soit ainsi. Je ne partirais pas comme un vaincu, mais comme celui qui s’est donné tout entier, et qui sait que la vraie tendresse ne retient pas. Si mon souvenir la blesse, qu’il disparaisse. S’il l’alourdit, même d’une plume, qu’il s’évanouisse. S’il entrave sa vie, qu’il se taise à jamais. Je ne dis pas cela avec grandeur, mais avec ce qu’il me reste de juste. Je n’ai plus besoin d’une place. Je veux qu’elle vive, qu’elle s’élève, qu’elle soit ce qu’elle est, là où elle est. Et si, au fond de son silence, elle ne me reconnaît plus, si mon nom ne remonte plus à ses lèvres, je la bénirai quand même. Car ce que j’aime, ce n’est pas le lien, ni le souvenir, ni ce que j’étais pour elle : c’est elle, dans sa vérité ardente. Même sans moi. Surtout sans moi. Aimer, c’est peut-être cela : consentir à s’effacer avec tendresse.
Je marche dans l’errance avec un « cœur de patte saignante » (3).
Je marche dans mon manque de vous.
Je marche à côté de moi, à côté de ce cœur arraché.
La fatigue de Dieu
« Afin qu’un jour, transposé,
Je sois porté par la danse de ces pas de joie
Avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi
Avec la perte de mon pas perdu
s’étiolant à ma gauche
Sous les pieds d’un étranger
qui prend une rue transversale (4). »
Je marche.
Quelle erreur ! Je croyais qu’en marchant le sang de la joie entrerait dans le mien. J’ai cru que le oui au pas de l’âne suffirait, que l’offrande allégerait, que son silence deviendrait paix, que son absence, ardente bénédiction. Mais ce soir ou ce matin — peut-être hier, je ne sais plus — je sens que je n’y arrive pas. Le cœur bat trop vite, trop fort, trop mal. Quelque chose cède en moi, lentement, comme une barque qui prend l’eau malgré mes efforts pour écoper. Je vacille. Et je n’en ai pas honte. Je vacille parce que je voulais être fort, celui qui bénit même les séparations, qui marche sans voix. Mais je ne suis que moi, un homme errant qui a dit oui à un amour trop vaste pour sa vie. Je suis fatigué. Fatigué de ne pas entendre sa voix. Fatigué de feindre la paix. Au fond, je l’appelle encore, en secret. Je voudrais être dans la lumière de mon renoncement, mais je suis dans l’ombre, et j’ai froid.


Le Chemin ne console pas. Il consume. C’est tout ! Il répond par du vent, de la neige, de la pierre, ou de la poussière. On parle du Chemin comme d’une aventure intérieure, un lieu de transformation, d’éclairs. Ce n’est pas vrai. Le Chemin dépouille, fait taire, abêtit. Il oblige à continuer, à poser un pied devant l’autre, à respirer malgré tout. Il y a l’effort, le froid, la solitude, le chant discret d’un oiseau dans un arbre nu. Parfois, un mot, une pierre, un souvenir. Mais ce n’est pas une magie. Ce n’est jamais ce qu’on attend. Je suis parti en espérant perdre « mon pas perdu ». Et, je continue de marcher à côté de moi. Non, je ne désire pas être consolé. Noluit consolari. J’avance parce qu’il faut avancer. Parfois, j’aimerais m’arrêter, m’allonger sur la terre, fermer les yeux. Parfois, l’idée de mourir me traverse.


Jacob s’est battu avec Dieu, ou son ange, à mains nues, dans la nuit. Il n’a rien lâché, tenant la bénédiction dans ses bras blessés. Mais Élie s’est effondré. Il s’est couché sous le genêt et a murmuré : « Assez. Seigneur, prends ma vie. » (1 R 19,4). Un ange l’a touché : « Lève-toi, mange. » J’ai voulu m’endormir ainsi, sur les Monts du Forez (5), me glisser sous le vent et disparaître. Mais une tempête m’a arraché à la terre. La pluie fouettait mon visage, le brouillard m’engloutissait, opaque, presque blanc. Quelqu’un est venu me chercher dans la nuit.
Je suis Jacob et Élie, l’un et l’autre, l’un après l’autre : le veilleur blessé, l’endormi désespéré. Vivre dans l’amour, c’est peut-être habiter cet entre-deux, laisser coexister la lutte et l’abandon. Lutter, tomber, se relever, marcher encore. Aimer, encore...
Je vous aime dans l’ombre où s’éloigne votre voix ;
Je vous aime sans geste et sans gerbe de fleurs ;
Je vous aime au désert qui me creuse et m’envoie
Vers Celui qui sème en secret nos douleurs.
Je vous rends à Dieu
« Le papillon monte au ciel en titubant comme un ivrogne.
C’est la bonne façon. »
Christian Bobin, La grande vie, 2014.
Mais ce silence ! Cet affreux silence que je respecte parce qu’il vient d’elle. Ce silence douloureux, je le garde comme une consigne sacrée, comme s’il était éternel. Tout est figé dans une parole suspendue, une distance née de sa liberté. Pourtant, il faut continuer de vivre. C’est le plus difficile : porter un amour caché au monde, dans deux êtres encore vivants. Ni fuir, ni trahir. Accepter que ce silence soit, peut-être, la forme terrestre de notre éternité. Et si nos regards se croisent un jour, que ce soit avec cette blessure chaude et tendre que l’amour laisse quand il ne meurt pas, mais ne doit pas se dire. Que je puisse alors la regarder pour lui offrir en silence l’aveu que j’ai tant porté : “Je vous ai aimée, je vous aime, et je vous rends à Dieu”.
Qui suis-je, moi, pour encore vous nommer,
vous dont le silence déborde mes nuits ?
Et pourtant, je ne cesse de vous aimer —
comme une source vive qu’étreint la soif.
Vous vous êtes voilée d’ombre — par fidélité,
tournée vers une lumière que je ne peux voir.
Je l’ai compris bien tard :
il est des amours qu’on n’approche pas,
comme il est des anges qu’on prie sans oser les regarder.
Le Chemin ou comment s’abêtir
« Consolez-vous, ce n’est point de vous que vous devez
l’attendre, mais au contraire en attendant rien de vous que vous
devez l’attendre ». Pascal, Pensées, frag. 234.
Je marche. Sans savoir, sans toujours croire. Mes pas trébuchent, mais j’avance — poussé par une fidélité têtue, presque naïve, comme un enfant qui serre un fil invisible dans le noir. Je dis mon chapelet, perle après perle, sans entendre vraiment les mots. Je trace un signe de croix maladroit, et le mystère me frôle parfois, léger comme un souffle.
Mes jours sont sans éclat, sans magie. Juste un chemin de cailloux, rude, une persévérance qui vacille. Je tombe, oh oui ! Mon cœur s’effrite, mes yeux cherchent dans le vide. Parfois, je m’arrête — petite chose brisée — et je pleure, sans toujours savoir pourquoi. Mais je me relève. Pas par moi, non. Parce que ce Chemin que je croyais mien… ne m’appartient pas. Depuis le commencement, il repose dans des mains plus grandes, plus douces. Les mains du Christ. Des mains trouées qui ramassent mes larmes comme on cueille des miettes d’offrande.
Il est là. Jésus. Dans l’ombre discrète qui borde mes pas, dans le silence de ces pas qui se répètent. Ce Chemin n’a pas besoin d’être grandiose. Il n’a pas besoin d’éclat. Il est vrai. Vrai comme le Christ, qui m’aime dans ma faiblesse, qui fait de mes chutes la grâce de Son secours, et de mon pauvre cœur une crèche où Il repose.
En marchant, je m’abêtis (6) — pour ainsi dire. Mais sans cet "abêtissement", vivre serait devenu impossible. Mon cœur, dans sa poussée obscure, me conduit sur mille sentiers. Je les traverse, un à un, sans toujours savoir pourquoi, ni vers quoi. Et puis, peu à peu, mes forces s’épuisent. Me voici au bout du souffle. Mais peut-être… Lorsque je m’abandonnerai — enfin, véritablement, au-delà même de ma propre mort à moi-même — je renaîtrai en source. Oui, en source vive, en source rapide. « Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort (7). »
Ora et ambula !
Eric Trélut, Gabat
Nota :
(1). Dante Alighieri, La Divine Comédie, « Le Paradis », chant 27, 102-105.
(2). Hector de Saint-Denys Garneau, Accompagnement, « Poésies. Regards et jeux dans l’espace. Les Solitudes », Montréal, Fides, 1972.
(3). Gaston Miron, Monologues de l’aliénation délirante, « Vie agonique », 1963.
(4). Hector de Saint-Denys Garneau, Accompagnement, « Poésies. Regards et jeux dans l’espace. Les Solitudes », Montréal, Fides, 1972.
(5). Les Monts du Forez s'étirent entre la Loire et le Puy-de-Dôme, dans le Massif central, comme une prière oubliée entre deux provinces. Ils forment une chaîne douce et silencieuse, culminant à environ 1 600 mètres, là où les Hautes-Chaumes déroulent leurs plateaux battus par le vent, leurs landes rousses et leurs ciels toujours changeants. À l’ouest, c’est l’Auvergne qui regarde ; à l’est, c’est le Forez ancien, cette plaine ligérienne qu’habitaient les comtes et les laboureurs. Le col du Béal, les jasseries d’estive, les hêtraies et sapinières, les sources limpides : tout ici respire une simplicité forte, une densité de silence. Terre de solitude et de pastoralisme, les Monts du Forez ne crient pas leur présence — ils l’offrent à qui sait ralentir. On y marche comme dans une page de temps long. Ici, la lumière tombe en nappes, le vent siffle comme une psalmodie, et les pierres semblent garder mémoire du pas des moines.
(6). Pascal, Pensées, frag. 233 (édition Brunschvicg). Permettez-moi de citer Martin Steffens (L'Éternité reçue) : « Comme l’écrit Simone Weil : “Le corps est un levier par lequel l’âme agit sur l’âme”. On peut penser ici à Pascal, à ce mot d’ordre qu’on a pu trouver terrible ou détestable : “Abêtissez-vous”. Mais ce qu’il veut dire, c’est d’abord ceci : si tu veux te sanctifier, tu ne peux pas ne pas passer par le corps. C’est “en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes” que le libertin se rendra Dieu plus sensible. C’est en travaillant la bête qu’on a quelque chance d’être un peu plus l’homme qu’on est appelé à être. Finalement la vie religieuse n’est rien qu’une éducation physique de l’âme. Ora et labora dira la Règle de saint Benoît, la part orante de la vie spirituelle n’est rien sans celle laborieuse et labourante. “Quand le corps est cloué”, comme il advient dans le travail répétitif de la terre, comme il advient plus simplement quand on se met à genoux pour prier, “la partie errante de l’âme [sa part charnelle] s’agite, mais malgré elle est toujours ramenée au corps, et finalement s’épuise et disparaît”. »
(7). 2 Corinthiens 12,10.