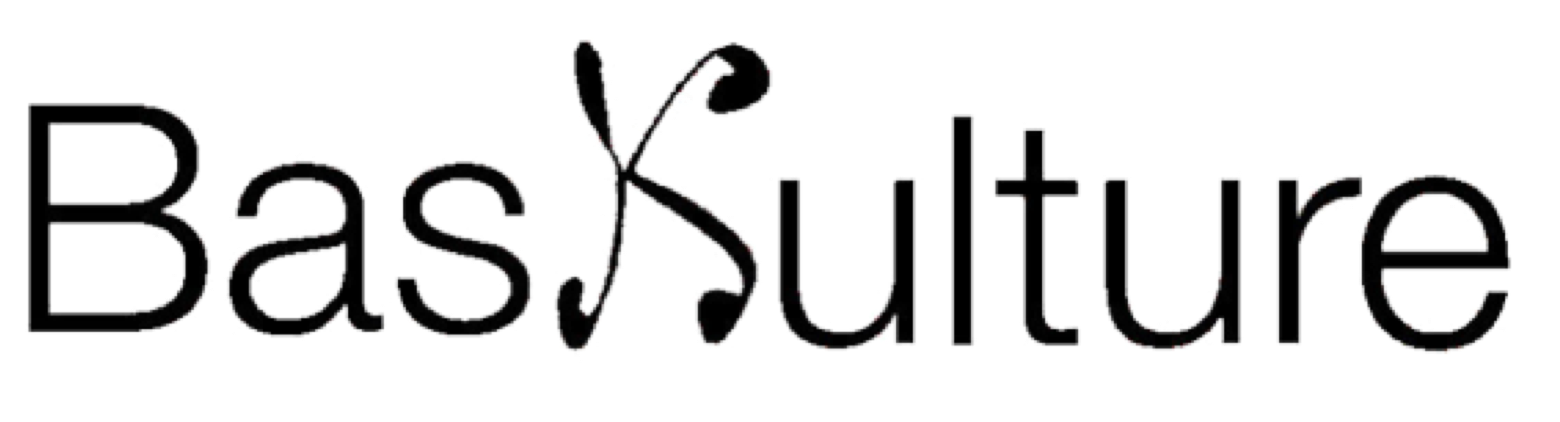Les premiers signes avant-coureurs de leur automne précoce, dès la fin du mois d’août, faisaient migrer des centaines de Russes – plus d’un millier annuellement, dont la majorité en septembre et en octobre – vers ces rivages ensoleillés où « le murmure de la mer et la brise embaumée leur donnait force et vitalité pour supporter ensuite dix mois dans leur chère, très chère, mais froide et sombre patrie ».
Dans sa recherche d’un climat sain pour ses enfants, doux et tempéré en hiver, ma grand-mère s’était déjà laissée précéder par tous ceux qui avaient fait la réputation de la plage des Rois ; particulièrement les soldats de Wellington qui, au gré de la retraite de la Grande Armée napoléonienne, avaient « ouvert » le pays à leurs compatriotes fuyant la révolution industrielle qui recouvrait progressivement l’Angleterre d’un manteau d’usines aux fumantes cheminées.
En 1909, le voyage en train depuis Pétersbourg durait plusieurs jours, avec une étape plus ou moins longue à Paris, pour changer de gare et effectuer des achats. Mon père n’était pas encore né, mais son aînée « Elitchka » – surnom affectueux donné à ma tante Elisabeth que je ne connus jamais – souffrait des bronches, et un séjour réparateur à Biarritz pour combattre les affections pulmonaires était à l’époque fort en renom parmi la médecine russe.
Or douze ans plus tôt, une violente crise d’hémoptysie, qui devait l’aliter à Moscou pendant des mois, n’y avait-elle point déjà attiré l’écrivain Anton Tchékhov ?
Mon grand-père, qui venait d’être nommé par son ami et voisin de propriété, le président du conseil des ministres Stolypine, à la tête du « Magistrat » ou gouvernement de Varsovie afin d’y préparer une évolution de la Pologne vers l’autonomie sous le sceptre de l’empereur de Russie, ne pouvait certes quitter une fonction aussi importante.
Grand-mère Hélène entreprit donc seule ce voyage, avec ses trois enfants, leur gouvernante et le reste du personnel domestique répartis dans plusieurs compartiments du train.
Le « Nord-Express », qui circulait alors deux fois par semaine entre Saint-Pétersbourg et Paris, était composé de massifs wagons-lits de la célèbre « Compagnie Internationale », dont la couleur marron-sombre enchâssait une tapisserie intérieure de cuir rehaussée de miroirs, de boiseries et de cuivres scintillant à la lumière de « lampes-tulipes ».
Le train s’ébranlait, laissant sur le quai les hauts bonnets de peau noire aux aigles d’argent coiffant les tuniques bleu ciel à aiguillettes rouges de la gendarmerie russe ; le convoi semblait prendre de la vitesse au gré du monotone défilé de steppes marécageuses où les sombres forêts de sapins étaient comme piquetées de la clarté fugitive des bouleaux du paysage russe. Leur succéderaient, au bout d’une journée de voyage ponctuée de parties de cartes aux « Douraki », la bruyère et les pins allemands. Car, aussitôt franchie la frontière entre les deux empires par le pont reliant Verjbolovo à Eydtkuhnen, la large voie ferrée russe se rétrécissait pour adopter le standard européen, et les troncs de bouleaux laissaient la place au charbon pour l’alimentation de la locomotive. Mais l’on troquait aussi les amples et confortables voitures du réseau russe, « sans rivales parmi tous les chemins de fer de l’Europe, qui permettaient de respirer et de voyager sans la moindre fatigue », contre les « sleeping-cars » de Berlin ou de Cologne, étouffoirs agités de violents cahots.
Le train ralentissait maintenant dans la traversée de quelques grandes villes allemandes, paraissant presque érafler au passage le fronton des maisons tout de briques revêtues. Au matin suivant, les fils télégraphiques, qui n’avaient guère quitté les voyageurs depuis Pétersbourg, accompagnaient désormais la fuite des saules belges encadrant leurs champs humides, avant l’arrivée à Paris, vers quatre heures de l’après-midi.
Une nuit de repos, et l’expédition reprenait dès la mi-journée, cette fois à bord du « Sud-Express » en direction de Madrid qui laissait nos voyageurs, vers dix heures du soir, à la gare de Biarritz, dans le quartier de La Négresse. Il s’agissait encore de gagner le centre de la ville, et ses grands hôtels bercés par le murmure de l’océan…
(…)
Au mois d’avril 1907, les princes Bariatinsky, qu’il avait précédemment mariés, accompagnaient l’archiprêtre recteur de l’église russe de Biarritz pour accueillir sur le quai de la gare de La Négresse l’impératrice douairière Marie Fedorovna, veuve d’Alexandre III et mère du souverain régnant Nicolas II ; avec eux, la famille du grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch au grand complet (qui résidait à Biarritz), les comtes Orloff-Davidoff, la comtesse Apraxine, et une suite nombreuse composée de membres de la colonie russe et d’autorités locales, assistaient à l’arrivée du train spécial, parti la veille de Calais.
Composé de neuf voitures vertes aux filets d’argent et au toit blanc, le convoi et sa quarantaine d’employés revêtus de l’uniforme militaire des chemins de fer russes ne manqua pas de produire son effet dans la ville.
Le grand-duc Alexandre, son épouse et leurs enfants pénétrèrent d’abord dans le wagon impérial pour en ressortir avec la souveraine, suivie de son chambellan, le prince Georges Dimitriévitch Chervachidze, et de sa demoiselle d’honneur, Catherine Sergueievna Ozeroff.
Après la présentation du sous-préfet et du maire qui lui souhaita la bienvenue, l’impératrice reçut encore une gerbe de roses, de lilas et de violettes, tendit sa main à baiser aux personnes venues la saluer, et les invités purent traverser le salon de la gare, décoré de drapeaux aux couleurs des deux pays, d’écussons aux armes des Romanoff et orné de massifs de plantes vertes, d’hortensias et de marguerites dont les vives couleurs se détachaient sur le velours rouge des tentures à franges d’or.
Maria Feodorovna monta aussitôt dans l’automobile du grand-duc, que ce dernier conduisit lui-même jusqu’à l’hôtel du Palais où l’impératrice rejoignit ses appartements en compagnie de sa fille, la grande-duchesse Xénia.
(...) Lorsqu’ils quittèrent Biarritz, une foule nombreuse les accompagna à la gare de La Négresse. Les messieurs en chapeau haut de forme, les dames en grande toilette, entouraient l’impératrice qui avait fait distribuer trois mille francs aux pauvres de Biarritz et trois cents francs aux musiciens du 49e de ligne. « On vit alors entrer en gare le train spécial, tout blanc, astiqué, reluisant comme s’il sortait d’une vitrine. À chaque porte se tenait un serviteur russe en blouse, bottes et casquette, espèce de colosse à barbe. Une voiture entière fut remplie des fleurs qu’on avait apportées à la souveraine ». L’Impératrice entra dans son wagon-salon et, glissant d’une manière imperceptible dans un silence impressionnant, le train quitta Biarritz, emportant la souveraine et sa famille vers le palais de Gatchina, non sans qu’elle eût été encore saluée aux abords de Paris par le président Armand Fallières.
Alexandre de La Cerda (extrait de « La tournée des grands-ducs », Atlantica).