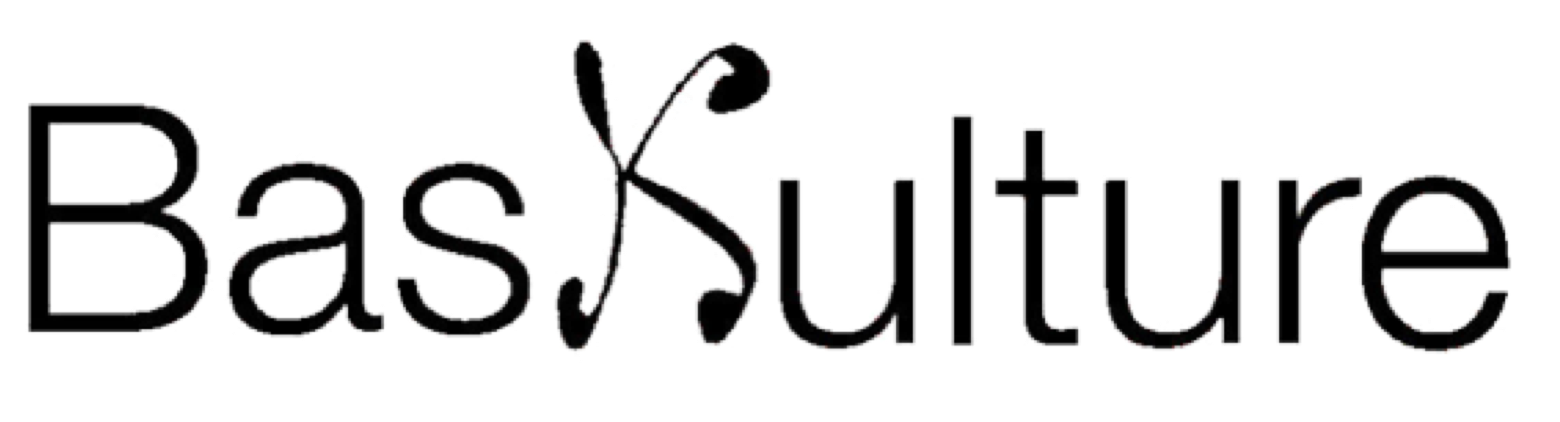« La grâce de Conques, c’est qu’il n’y a presque rien.
Je reconnaissais cette sensation, la même qu’à la lecture d’un
grand poème : une grâce d’apesanteur, un ralenti princier.
À Conques, la vie murmure qu’elle ne mourra jamais.
Seuls les yeux des bêtes et les soies froissées
des anémones savent ce que je veux dire. »
Bobin La nuit du cœur
1. Prologue – La chambre retirée
La pauvreté, c’est qu’on a moins. La misère, c’est qu’on est moins.
Mais la grâce, c’est qu’on a tout perdu… et que Dieu demeure.
Je suis revenu à Sept-Fons. Un soir d’hiver. Pour la première fois. Il a neigé le lendemain matin.
J’y étais venu deux fois, autrefois, pour enseigner. Avec mes livres — trop nombreux. Mes pensées trop belles sur les anges penchés sur le Cosmos.
Et cette grande chambre qui m’attendait. La n°1. Celle de l’évêque.
Je souriais à l’austérité cistercienne depuis un fauteuil un peu plus large. Un peu plus tiède. Un peu trop sûr.
Mais ce soir-là, ce n’était pas la même venue. Le pupitre est vide. Le silence a repris la salle. Le monde s’est détourné. Rien que le silence blanc des moines. Leur vêtement sans pli. Leurs pas comme des prières qu’on ne dérange pas. Ne faut-il perdre la chambre d’honneur pour goûter à la cellule d’amour ? Me laisser mouiller. Parce qu’une âme vernie ne mouille pas. Parce qu’une âme habituée, polie, exacte, ne se laisse pas traverser. Elle reste sèche, protégée, brillante et vide. Mais une âme entaillée, un peu ébréchée, devient poreuse à la grâce. Et la grâce ne cherche que cela : une faille, une fêlure, un abandon.
La liturgie des heures est mon seul horaire. Ma chambre n’est plus celle de l’évêque. C’est une cellule — comme toutes les autres. Un lit étroit. Une table nue. Pas de fauteuil.
Le soir est tombé comme une étoffe. Je me rends à l’église, toute proche, guidé par le silence. À l’heure des complies, je suis déjà ailleurs, comme porté hors du monde, suspendu. Une centaine de moines, blancs comme des cierges, chantent à voix basse devant le vitrail de Notre Mère de Miséricorde.
Leurs voix tissent l’air. Leurs voix éclairent le silence. Et leurs chants m’appellent.
Le lendemain, j’ai rencontré un prêtre. Il m’a parlé ce matin-là. Ce qu’il me dit fut comme un coup de couteau.
« Éric… pour aimer, il faut être libre. Et cette liberté, parfois, ressemble à de l’indifférence.
La passion est belle, mais elle enchaîne. On n’embrasse que des lèvres. Mais un sourire désiré… c’est autre chose. »
Je ne savais pas encore où j’étais appelé. Mais tout semblait me murmurer : « Viens ! » Je commence à comprendre que l’on peut être le plus heureux et ressentir si fort le désir de mourir. Ce sourire était si beau … que cela me fit désirer, désirer toujours.
Elle est venue à moi dans la lumière d’un sourire. Et je ne savais pas encore que ce sourire allait me dénuder jusqu’à Dieu.


Ceux qui ont tout prévu n’accueillent rien. Ceux qui n’attendent rien ne reçoivent plus. Ceux qui ne manquent de rien ne reçoivent pas ce qui est tout.
Mais moi, entre Sept-Fons et Conques, j’ai commencé à manquer. Et Dieu — au lieu de combler ce vide — l’a approfondi. Il l’a laissé devenir un abîme fleuri.
Je suis parti à pied. J’ai quitté Sept-Fons en silence. Chaque pas m’éloignait d’une chambre, d’un rôle, d’un savoir.
Chaque pas me rapprochait d’une faille. J’allais vers Conques. Et, si c’était Dieu qui m’approchait ?
2. Duel ou double chant entre Homme et Dieu
« Si avec un humain, dans le premier temps de la rencontre,
vous vous égarez dans le labyrinthe carrelé de blanc d’une convention,
vous le perdez à jamais. Si l’attaque — le coup de l’ange — est réussie,
vous le garderez toujours en vous. »
Bobin La nuit du cœur
Je ne vous cherchais plus, Seigneur,
Mais c’est dans l’ombre que je viens.
Je vivais loin de votre ardeur,
Là où tu ne me voyais rien.
Le vent s’était couché en moi,
Je suis l’absence dans tes mains.
Dans le silence sans pourquoi,
Le feu dormait sous ton chagrin.
Et puis je l’ai vue, sans détour,
Je me suis glissé dans ses yeux.
Son pas m’a reconduit au jour,
Elle portait ton cœur, le mieux.
J’ai reconnu votre splendeur
Dans la lumière d’un secret.
Un feu brillait, plus que l’ailleurs,
Mais c’était vous qu’elle aimait.
Pourquoi me la retirez-vous,
Ce feu que tu crois mort s’éveille.
Puisque c’est par elle que j’avoue
Que ton amour brille sans veille.
On me dit : « dépasse l’aimée,
Tu ne t’es pas trompé d’amour.
Marche plus haut, sois transformé »,
Je me révèle sans détour.
Mais moi, c’est vous que j’ai trouvé
Je change l’eau, je romps le pain.
Dans ce visage rencontré,
Je suis le feu dans le matin.
Et maintenant ? Que reste-t-il
Il reste l’offrande fidèle,
Quand tout s’efface, pure exil ?
Ton cœur me bat, loin de l’oubli d’elle.
Vous me l’avez donnée un soir
Je l’ai offerte comme passage,
Comme un seuil entre deux espoirs.
Un chant d’amour, un doux langage.
Et vous m’ordonnez de la voir
Mais chaque amour devient message
Partir sans voix, sans au revoir.
Quand il rejoint mon propre outrage.
Alors j’avance, et je vous crie
Avance encore, sois transparent.
Dans ce désert, cette patrie :
Je suis en elle et dans ton chant.
Ce n’est pas moi qui la choisis,
Celui qui donne en s'arrachant
C’est vous que j’aime et que je dis,
Me touche au cœur — en m’embrassant.




Et s’il me faut marcher encor,
Que ce soit nu, sans réconfort.
Mais que mon pas, même tremblant,
Soit un je vous aime… sanglant (1).
3. Conques – coups de lumière
« Les pèlerins vont au ciel à pied. L’inégale conversation des pierres
durcit leur voûte plantaire, leur invente un fer à cheval en corne. »
Bobin La nuit du cœur


Il pleut. Conques est ce village introuvable qui se révèle au détour d’une colline, comme une chose qui attendait depuis mille ans que je la voie. Rien ne l’annonce vraiment. L’abbatiale surgit. Elle s’offre sans bruit, dans un creux de vallon, repliée comme une main en prière. Il n’y a pas de cris, pas de drapeaux, pas de panneaux. Juste cette présence de pierres du onzième siècle — humble, persistante — qui vous regarde avant même que vous ayez levé les yeux.
« Conques, c’est une rue et une seule. » Au bout de cette rue en pente, l’abbatiale Sainte-Foy est là, droite et grave, belle de cette beauté qui ne cherche pas à plaire. Elle se dresse dans le silence comme une pensée dressée dans l’air, vêtue de pierres roses, grises ou blanches. Les nuages, au-dessus, s’effilochent comme des larmes retenues.
Mes pas ralentissent. « La pente me repousse, fait tout pour me décourager. » Quelque chose en moi baisse les armes. Je suis fatigué. « C’est une lutte plus qu’une marche. […] Il y a une théologie des pentes. On ne peut les vaincre qu’en allant contre soi. (2)»
Le chemin m’a porté jusqu’ici. Maintenant, je découvre une porte. « La porte de l’abbatiale est celle du condamné à mort. » (Bobin) Le choc est net. Quelque chose m’arrête net — doucement pourtant — comme une main sur l’épaule. Là, au portail de pierre. « Sur le seuil notre escorte de soucis s’arrête net. » (Bobin) Je suis arrêté. Je regarde. Ou plutôt : je suis aussi regardé. Les damnés tombent. Les justes s’élèvent. Et moi, je reste au milieu. Je ne sais plus très bien dans quelle direction va mon cœur. Vers le haut ? Vers le bas ? Vers une brûlure ? Vers une miséricorde ? Et j’entre seul vers l’autel des sacrifices.
Il y a, dans mes pas, le besoin irrépressible d’être sauvé — non pas sauvé de la mort, mais sauvé de tout ce qui précède : la grâce trop haute, la laideur trop vraie, l’amour trop immense, et le manque d’amour, trop vide ; le besoin de sauver, jour après jour, à chaque pas de mon âme, « le chemin de Dieu en marche (3)». Partout, des abîmes. Et au-dessus de tout amour… un amour plus haut encor. C’est vers Lui que montait, doucement, inexorablement, chacun de mes pas. Conques n’est ni douce ni tendre. Elle est rude comme une exigence d’amour folle. Elle demande tout. Radicalement. Totalement. Elle ne laisse rien.
Alors j’ai baissé les yeux. Et je suis entré.
L’intérieur est silence. Les pierres, tirées de carrières rose pâle, jaune pâle, bleu pâle, parlent bas. On dirait qu’elles savent tout — déjà. Je m’agenouille, presque machinalement, devant l’autel du sacrifice où Jésus m’attend, parce que c’est le seul geste encore possible.
Et la récitation du chapelet.
Autrefois, ils n’ont pas voulu de ces 104 vitraux. Trop froids, trop vides. Ils voulaient des saints, des récits, des figures familières. Mais Soulages savait que Dieu ne se peint pas. Et que parfois, l’absence est le plus haut des langages. Comme le manque est la plus haute forme de l’amour ; celui qui ne peut rien rendre. Soulages a inventé un verre que nul autre ne savait faire. Un verre qui désire la lumière comme une source qui a soif.
Je sors. Le soir tombe. De l’extérieur, les vitraux sont gris. On croirait qu’ils sont morts. Des pèlerins pleurent devant ces vitres. Parce qu’elles laissent parler ce qu’ils n’osaient plus écouter. Aujourd’hui, je suis le seul pèlerin, et je ne pleure pas. Mais je ne suis pas devenu plus pur. Plus transparent, peut-être. Plus traversé. Transpercé, sûrement. Presque rien.
L’hôtellerie de l’abbaye me reçoit. À mon arrivée, un frère prémontré m’accueille. Il me sourit avec un verset sur les lèvres. « Ici, à Conques, me dit-il, l’hospitalité n’est pas un devoir. C’est une vieille parole, froissée par les siècles : « Frères, n’oubliez pas l’hospitalité : certains, sans le savoir, ont accueilli des anges (4). » Je n’étais pas un ange. Mais peut-être que lui … n’avait jamais cessé d’en être un.
Ici, on se sent inexplicablement aimé.
Eric Trélut, Gabat
« Il n’existe pas d’« intelligence » artificielle.
La racine de l’intelligence, son centre invisible à partir de quoi tout rayonne, c’est l’amour.
On n’a jamais vu et on ne verra jamais d’« amour artificiel ».
Bobin La nuit du cœur


Notes
(1) Il est ces vers écrits en juillet 1897, que Rilke reprendra dans la seconde partie du Livre d’heures. Ce recueil, dédié à Lou, sera publié en 1905 :
« Éteins mes yeux : je te verrai encore
Bouche-moi les oreilles : je t’entendrai encore
Sans pieds, je marcherai vers toi
Sans bouche, je t’invoquerai encore
Coupe-moi les bras : je te saisirai
Avec mon cœur comme avec une main
Arrache-moi le cœur et mon cerveau battra
Et si tu mets aussi le feu à mon cerveau
Je te porterai dans mon sang ».
(2) Christian Bobin, La nuit du cœur, Gallimard, 2018.
(3) Le Saint n’est pas quelqu’un de parfait, ce n’est pas quelqu’un de valeur, c’est quelqu’un qui ne vaut rien, c’est quelqu’un qui n’est rien. Mais, par ce rien, Dieu passe, comme l’eau d’une source par le vide grand ouvert d’un conduit, pour aller donner aux âmes sa Grâce à boire. Le Saint est bon conducteur de Dieu. » Marie Noël, Notes intimes, 1940-1958.
(4) Lettre aux Hébreux 13,1.