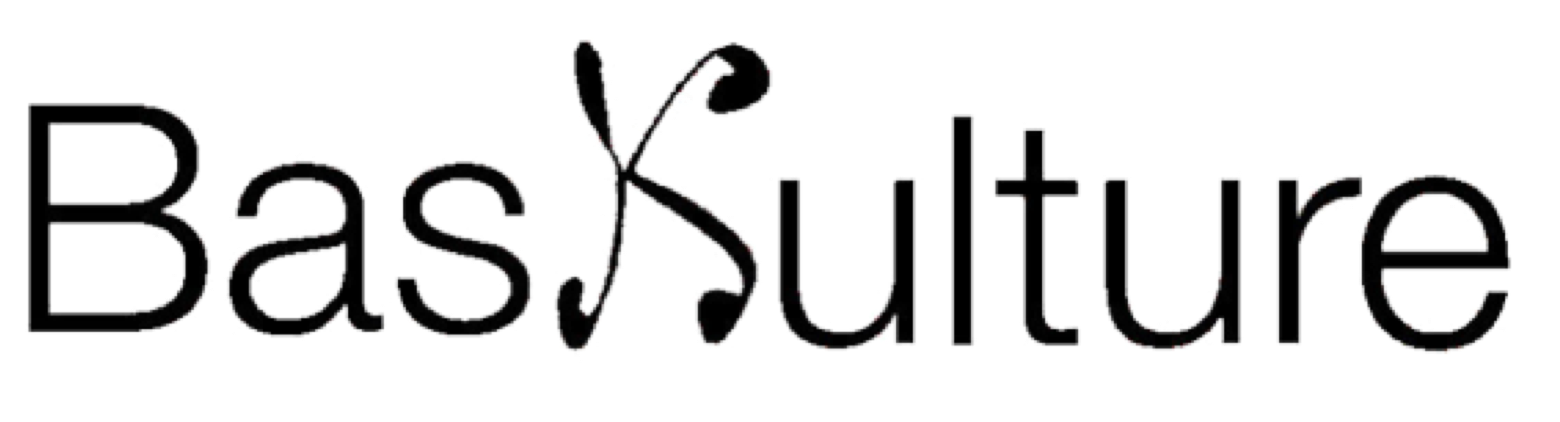Charles de Koninck au « royaume des elfes » (1)
« Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
Puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
Puisque je rirai dans l’une d’elles,
Alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles » (2).
« Par la grâce du poète, nous sommes devenus le pur et simple sujet du verbe s’émerveiller » (3).
Pourquoi chérir une étoile ?
Sur une façade de pierre, une plaque de marbre murmure aux passants un secret :
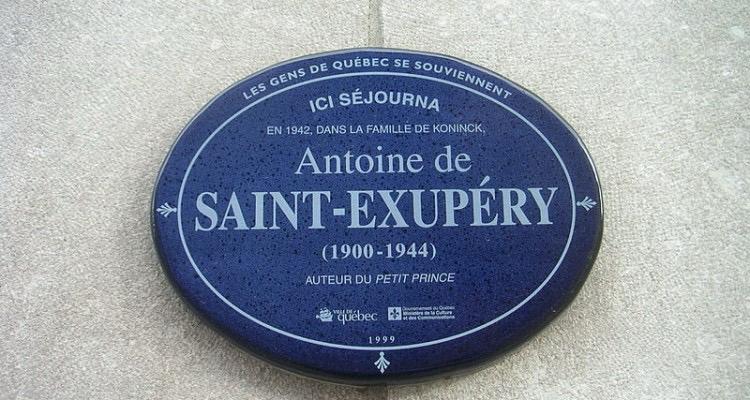
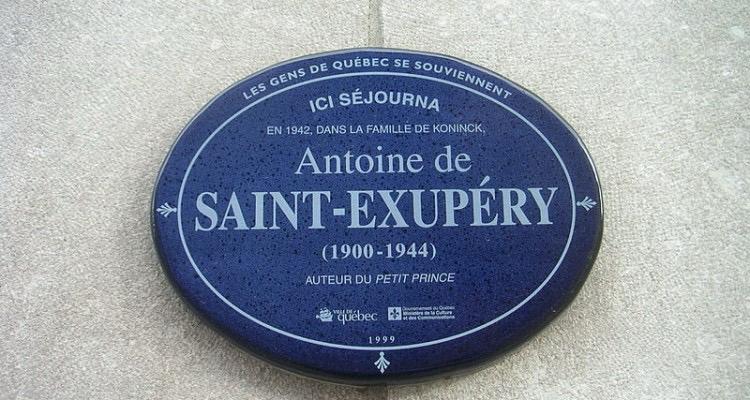
« Ici séjourna, en 1942, chez la famille De Koninck, Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince. »
En mai 1942, Saint-Exupéry, aviateur et écrivain, donne une conférence au Palais Montcalm de Québec, sous l’égide de l’Institut canadien.
De passage dans la province à l’invitation de son éditeur Bernard Valiquette, il retrouve son ami Charles de Koninck, avec qui il entretient une correspondance régulière et qui a organisé sa venue.
Après la conférence, quelques intellectuels se rassemblent chez les De Koninck, dans leur grande maison du 25, rue Sainte-Geneviève, blottie au cœur du Vieux-Québec.


Mais Saint-Exupéry, lui, s’échappe. Il délaisse les conversations par trop érudites, laisse à d’autres le soin d’arpenter les hauteurs arides de l’abstraction, et descend rejoindre les enfants.
Il leur montre comment plier des avions de papier, trace sous ses doigts quelques esquisses à la hâte. Un monde s’ouvre alors, plus vaste que celui des savants, un monde d’ailes fragiles et de songes griffonnés.
L’aîné des De Koninck, Thomas (4), huit ans à peine, l’assaillit de questions. Saint-Exupéry l’écoute, sourit, s’émerveille peut-être de cette curiosité insatiable, de cette manière qu’a un enfant de vouloir comprendre sans jamais s’arrêter.
Qui sait ? Peut-être, sans le savoir, cet enfant-là lui inspira-t-il un prince à l’écharpe d’or, un voyageur aux mille pourquoi, un astre solitaire perdu dans l’immensité des étoiles.
L’année suivante, en 1943, le Petit Prince paraîtra.
Godelieve de Koninck, dans ses souvenirs d’enfance, évoque cet instant suspendu :
« Je le revois, le coude appuyé sur la tablette de la cheminée, silencieux. Il avait les cheveux noirs, lisses, une physionomie indéfinissable, des yeux profonds qui nous traversaient comme des rayons X. Il semblait ailleurs. Puis, comme par enchantement, il disparaissait de la table des adultes et se retrouvait avec nous, au sous-sol. Il s’asseyait par terre, nous fabriquait des avions en papier, les lançait à travers la pièce. Thomas lui posait des questions. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Peut-être un peu à la façon du Petit Prince… »
L’émerveillement, ce fil d’or
« Ô Nuit, porteuse d’étoiles, bras tendu du silence !
Tu répands ton grand manteau sur l’âme qui veille.
Tout ce qui brille là-haut brûle aussi dans mon cœur » (5)
Charles de Koninck (6) regrettait que l’émerveillement fût passé de mode. Il voyait dans l’admiration et l’étonnement la source première de la philosophie et des sciences, un regard capable de percer l’apparente banalité du monde pour en révéler toute la splendeur cachée.
« Le but poursuivi aujourd’hui semble être de démontrer, de façon répétitive, que la Nature n’est “rien d’autre que…”. Admirer les choses et les processus de la Nature est considéré maintenant comme quasiment scandaleux. »
Nos concepts ordinaires, disait-il, sont la première source de la pensée. S’en détacher, c’est couper l’arbre à sa racine (7). À force de vouloir tout réduire, tout expliquer, tout utiliser, l’homme risque de perdre ce qui fait la force et la beauté du réel : sa gratuité. “Il ne fallait pas !” Il ne fallait pas que les choses fussent ce qu’elles sont (8).
Chesterton (9) l’avait bien vu :
« Tant que nous considérons qu’un arbre est une chose évidente, créée pour qu’une girafe la mange, nous ne pouvons pas nous émerveiller devant lui. C’est lorsque nous y voyons une vague prodigieuse du terreau vivant s’étirant vers les cieux sans raison particulière que nous mettons chapeau bas. »
L’émerveillement n’est pas un luxe, il est le seuil de la connaissance. Il est cette fine broderie d’or, presque invisible, qui lie secrètement l’enfant au philosophe, l’éphémère à l’éternité, l'étonnement d'un instant à la sagesse d'une vie.
Regarder ensemble
« Nulle part ne sera le monde, si ce n’est en nous.
Notre vie passe en métamorphose. Et toujours moins
Nous connaissons le visible, et ce qui fut hors de nous
Se fait intime peu à peu, et notre intérieur grandit » (10).
Imaginez.
« Si quelqu’un aime une fleur qui n’existe qu’à un exemplaire parmi les millions et millions d’étoiles, cela suffit pour qu’il soit heureux en les contemplant. Il se dit : Ma fleur est là, quelque part… » (11)
Mais s’il sait qu’au moment précis où il lève les yeux vers le ciel, sa fleur, où qu’elle soit, contemple, elle aussi, la voûte étoilée, alors l’amour devient plénitude. Ce n’est plus seulement une pensée portée sur l’absent, mais la certitude d’un regard partagé.
Sous ce ciel, ils sont deux : elle là-bas, lui ici. Un seul regard levé.
Il murmure en son cœur :
« Ma fleur est là, et elle me voit comme je la vois. Entre elle et moi, l’univers n’est plus qu’un miroir, un écho tendre de lumière qui nous lie par-delà la géographie. »
Imaginez encore. Et plus…
Lorsque le soir viendra poser sa cape sur ses épaules, levant les yeux, les étoiles ne seront plus de simples braises suspendues dans l’infini. Elles deviendront les veines d’un ciel réparé, une lumière qui coule dans les fissures du monde. Comme ces porcelaines brisées que l’on soude d’or Kintsugi (12), la nuit ne dissimule plus l’absence - elle la magnifie. C’est pourquoi tressaillent toutes les étoiles. Elles tremblent bleues, tout là-haut !
Il sait, sans preuve ni mots, qu’un autre sourire s’élève sous cette même voûte silencieuse.
Elle…Lui…
Elle, là-bas, loin de lui, là où la Terre glisse en l’ombre du jour. Loin, si loin, mais jamais en un autre séjour. Sous la même nuit, traversée du même frisson d’étoiles, la géographie aurait pu les dissoudre, les éparpiller. Mais non. Un tendre souffle tisse l’espace avec des fils de lumière. Chaque étoile est une couture d’or sur le velours noir de la nuit.
Deux amants séparés par la Terre,
mais unis dans le secret par le Ciel,
un seul regard
qui veille sous les étoiles,
une même prière murmurée
au creux profond de la nuit.
Alors, pourquoi chérir une étoile ? Parce que, quelque part sur Terre, une merveille émerveillante lève les yeux vers elle. Parce que son regard humain, silencieux et ravi, lui prête son éclat secret. Et dans cet échange mystérieux, la nuit murmure en nous que le Paradis n'est jamais loin.
« Regardez le ciel. Demandez- vous [...] »
Eric Trélut, Gabat
Notes
(1) Selon une magnifique expression de Gilbert Keith Chesterton dans Orthodoxie (1908).
(2) Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Chapitre 26, 1943.
(3) De Gaston Bachelard cité par Henri Raynal, dans L’Œil magique, Paris, Seuil, 1963, p. 9.
(4) À l’émission Contrechamp du 21 décembre 1983 consacrée à Saint-Exupéry, la journaliste Marthe Blouin demande à Thomas De Koninck s’il confirme être le Petit Prince comme le croient certains : « Ce que je sais, c’est que je lui posais des tas de questions. On me reprochait d’être bavard. Enfin quelqu’un qui écoutait. [...] Il y a mon épouse qui a dit "[le Petit Prince], c’est sûrement toi". Elle est certaine que c’est vrai parce qu’elle dit que je viens d’une autre planète ». (Thomas de Koninck).
(5) Paul Claudel, Cinq Grandes Odes, Ode IV « La Muse qui est la Grâce », 1910.
(6) Charles de Koninck, L’Univers creux, in « Œuvres de Charles De Koninck », T.1, vol.1, PUL, 2009.
(7) Selon Henri Raynal (« La condition cosmique ». Revue du MAUSS, n° 55(1), 375-383) : « Non seulement l’être humain de ce temps est déraciné – il est hors-sol – mais il est déciellé. Il n’est plus nulle part. Il est moralement nu et vit sans repères. Les écrits de l’époque en portent témoignage, surabondamment, privilégiant l’errance, le marasme psychologique, le désenchantement, la désespérance, la dérision ». Au fond, l’homme (humus) ne peut être sur Terre que s’il est en vérité enraciné dans le Ciel.
(8) Selon Gilbert Keith Chesterton dans Orthodoxie (1908) : « C’est une chose que de raconter une entrevue avec une gorgone ou un griffon, une créature qui n’existe pas, c’en est une autre de découvrir que le rhinocéros existe bel et bien et de se réjouir de constater qu’il a l’air d’un animal qui n’existerait pas ». Il ne fallait pas que cela soit mais cela est et nous nous en réjouissons.
(9) Gilbert Keith Chesterton, Le paradoxe ambulant, 59 essais choisis par Alberto Manguel, Actes Sud, 2004.
(10) Rainer Maria Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, 1910.
(11) Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Chapitre 26, 1943.
(12) Le Kintsugi (金継ぎ, littéralement « jointure d’or ») est un art japonais ancestral consistant à réparer les céramiques brisées en soudant les fragments avec de la laque saupoudrée d’or, d’argent ou de platine. Plutôt que de masquer les cassures, cette technique les met en valeur, transformant la blessure en ornement, l’accident en beauté. Philosophiquement, le Kintsugi s’inscrit dans la pensée du wabi-sabi, une esthétique japonaise qui célèbre l’imperfection, l’éphémère et la simplicité. Il enseigne que la rupture n’est pas une fin, mais le début d’une nouvelle forme de plénitude. Ce qui était fissuré devient plus précieux qu’à l’origine, non malgré sa fragilité, mais grâce à elle.