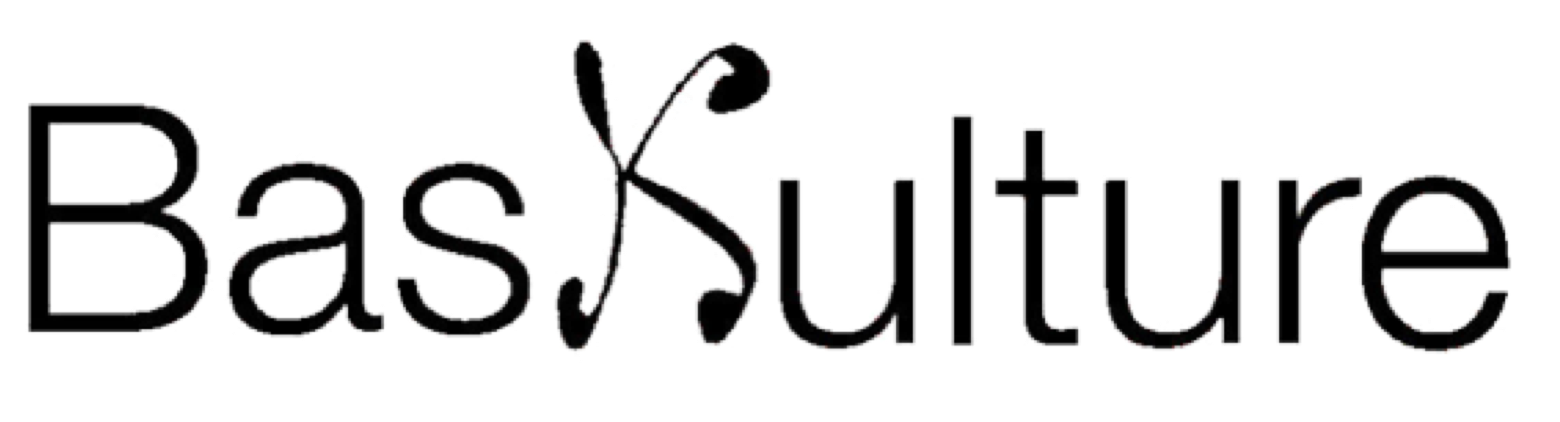Ne souriez pas : les synthétiseurs modernes n'ont point renoncé aux étranges bruits et vacarme et tumulte qui fermaient jadis le temps de l'office des ténèbres, lugubre, sombre et recueilli de la Semaine Sainte. Du nom latin de strepitum, un ancien rite romain donné à l'office des laudes, des vigiles les Jeudi-Vendredi-Samedi Saints d'attente impatiente du Ressuscité par les psaumes et le récit évangélique des Écritures sacrées.
Après l'oraison, le célébrant fait un bruit sonore sur sa stalle, on imagine un de nos pieux chanoines d'antan disparus depuis lors, faisant du son d'appel de pied sur ces planchers de bois pour exprimer "le désordre de la nature à la mort du Sauveur", rien de moins que des accords amplifiés désormais de baffles modernes dont la portée serait plus large aujourd'hui. Dans un missel d'il y a cent ans à peine, on mentionne le passage de l'Évangile de Matthieu : "la terre trembla et les rochers se fendirent après la mort du Christ en croix" Mt 27, 51.
Il fallut donc le vivre en vrai et non en image empruntée.
Les musiques métal modernes en assureraient le débit, mais on n'imagine guère la liturgie contemporaine s'éloigner de ce symbole et renoncer à allumer le lumignon sobrement, pour renoncer au tintamarre et retrouver le silence de la nuit, sans excès sonore.
On prétend - selon les chroniqueurs du passé - que le rite apparut au Moyen Age, au milieu de pratiques allégoriques et expressionnistes chez les Francs, singularité gauloise, les Francs aimant déjà les fantaisies propres à leurs parlers et idiomes provinciaux par des scenarii théâtraux représentant des séquences telles les femmes allant au tombeau, costumées de circonstance, de confréries cabotines que la liturgie encadrée du droit canon sélectionnait, ces scènes habitées de dramaturgie lors de la mise en terre au Samedi Saint du corps de Jésus par exemple, et bien des fantaisies vestimentaires attachées de fouloirs, de voiles au féminin, de coiffes au masculin, donnant libre cours à la spontanéité de ces figurants non cléricaux mais séduits par le rite du moment. Le choix du costume n'était jamais neutre à chaque époque du temps.
Dans le bréviaire romain, disent les chroniqueurs du temps, en 1568 par Pie V, on parle du strepitum en usage et désormais consigné dans un missel. On parle d'un bruit contenu mais de toute probabilité plus sonore en quelques quartiers de toute ville que dans les lieux confidentiels des cultes de la Semaine Sainte, plus réservés autrement.
On vit des casseroles venir troubler, que dire harmoniser le rituel et les coutumes dans des églises parisiennes s'entend, mais de peu de latitude selon le Dictionnaire des cérémonies et des rites sacrés de 1848, "qui déplore que l'on s'éloignait de l'esprit de l'Église en souffrant que des enfants dissipés fissent un tumulte indécent en ces lieux sacrés des offices."
Conseil d'usage, pour ne dissuader les fidèles attachés à ce signe insolite en liturgie, les auteurs du rituel conseillaient qu'il ait lieu à la sortie de l'église accompagné de silence. Difficile d'accorder dans l'esprit gaulois et parisien et la manif des uns, et la manif des autres sans froisser la sensibilité de chacun en ces cas très peu fédérateurs !
Pour le Jeudi Saint, le strepitum faisait place lors du lavement des pieds a la représentation théâtralisée de la purification de chacun, avant la prière eucharistique elle-même qui laisse peu de place à cette spontanéité.
Le Chemin de Croix du Vendredi Saint est bien porté par ce rapport mimétique laissé à chacun de s'identifier à un drame spirituel et personnel de Jésus portant lui-même Sa propre mort sur Sa propre Croix, non sans engendrer des transgressions spirituelles comme avec le strepitum pour tenir un langage didactique et pédagogique ouvert à la croyance individuelle, sans autre désir que de l'exprimer librement, pour d'autres témoins encore.
Curieusement, c'est la modernité relative du Concile de Trente, puis de Vatican II, qui dépouillent la liturgie de ces éléments sensibles de tout rapport à la vie, au regret de certains de renoncer à ces signes sensitifs qui rendent le mystère proche et accessible à tout un chacun.
Le strepitum n'est plus dans l'espace sacré des cultes. Mais le strepitum demeure dans ces vocalises profanes et parfois sonores des appareillages phoniques modernes qui inventent des sons et des voix que les cordes naturelles ne pourraient produire mais sont possibles par moyens numériques modernes. Les liturgies profanes modernes en regorgent.
Alors instruits de sagesse et de prudence, nos liturges religieux évoquent "la nécessité de ne jamais les abandonner totalement dans la liturgie par le rapport au mystère contenu par les sens et des rites ajoutés à l'écriture elle même."
On essaie de retrouver cette dimension sensible par la lumière mais de toute évidence d'autres expressions sont possibles. Strepitum ne s'est pas tu et ne taira jamais sa voix ni son énergie pour ancrer le saint office de la parole divine à des formes libérales des sensibilités modernes existantes.