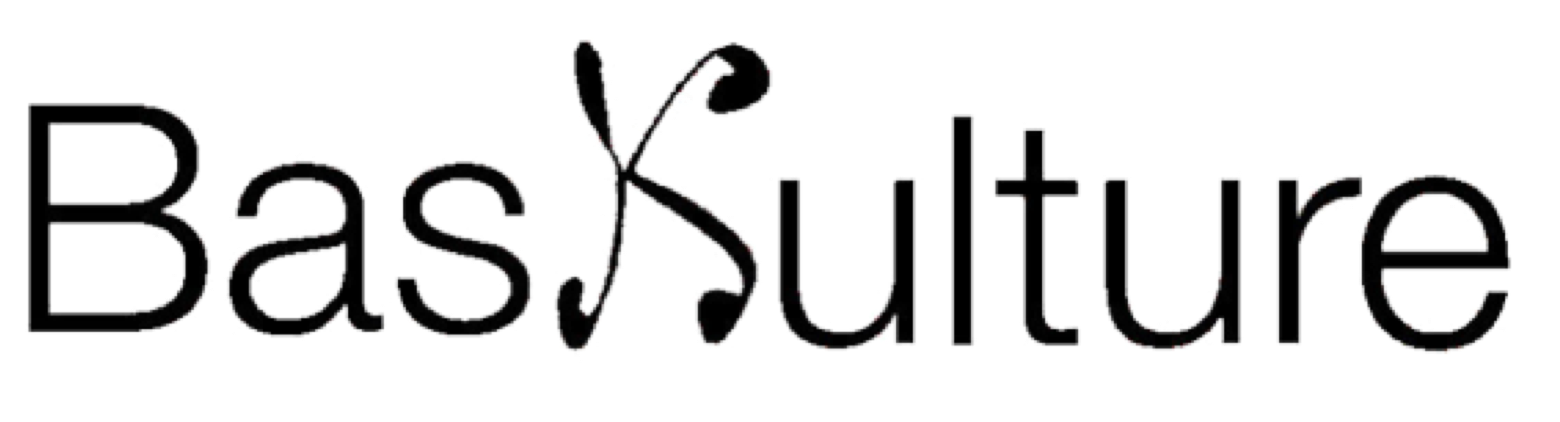La prochaine conférence de l’Université du Temps Libre de Bayonne aura lieu ce vendredi 28 mars à 15h au Centre municipal de réunions (10, place Sainte-Ursule, à Saint-Esprit).
Jean-Yves Roques, Conférencier, Enfance de l’art, présentera : « Dans le miroir de Velasquez ».
En 2017, déjà, Jean-Yves Roques avait traité le thème « Vélazquez, le miroir et le fil » à la médiathèque de Tarnos.
Instruit de ce que la peinture peut accomplir de meilleur à l’issue de la Renaissance après Titien, Caravage et Rubens, Vélazquez devient peintre officiel de la puissante Espagne de Philippe IV. Fort de ses « bodegones », de ses mythologies, de ses portraits, il ira poser son chevalet au milieu des couloirs et des prestiges du palais.
En 1649, Diego Vélasquez a 50 ans. Peintre officiel de la cour d'Espagne, il est envoyé en Italie pour acquérir des œuvres.
Grand amateur d'art, Philippe IV lui confie la mission de lui rapporter de nouvelles oeuvres en Italie. Il part avec son esclave, Juan de Pareja. Arrivé à Rome, il visite les galeries et les collections Borghese, Farnese, Mattei ou la Villa Médicis, accompagné du peintre Antonio Domenico Trivia, grâce à l'appui bienveillant du pape Innocent X qui lui demande en échange de peindre son portrait. Il profite aussi de l'ambiance italienne, très différente de celle qui règne en Espagne où sévit encore l'Inquisition. La vie semble plus légère, les peintres sont audacieux. Ainsi, il s'étonne qu'il y ait tant de toiles de nu. Et pour la première fois, lui qui s'est spécialisé toute sa vie dans le portrait, il songe à se consacrer à la peinture d'un nu.
Ainsi, de ce voyage, Vélazquez rapportera une toile personnelle, le seul nu de sa carrière : « Vénus à son miroir ».
Un tableau qui subit diverses avanies : le 10 mars 1914, à la National Gallery de Londres, vers midi. Une jeune femme entre, parcourt les salles et se dirige vers le chef-d’œuvre dont s’enorgueillit le musée, « La Vénus au miroir » de Diego Velázquez. Soudain, elle sort un couteau et lacère la toile à sept reprises, notamment au niveau du postérieur de la femme représentée ! Emportée par les gardiens, elle s’écrie : « On peut remplacer des tableaux, mais pas des humains. Ils sont en train de tuer Madame Pankhurst ».
De fait, Emmeline Pankhurst et Mary Richardson – à l‘origine de l’acte de vandalisme –, étaient des suffragettes, c’est-à-dire des activistes luttant pour le droit de vote des femmes. Mary Richardson expliquera son geste : « J’ai essayé de détruire l’image de la plus belle femme de la mythologie pour protester contre le gouvernement, qui détruit [...] le plus beau personnage de l’histoire moderne ». Et c’est bien la déesse de la beauté que l’on voit sur le tableau, allongée et lascive, face à un miroir.
Cette peinture sera de nouveau vandalisée dans la matinée du 6 novembre 2023 dans le musée londonien : deux militants "écolos" briseront à coup de "marteaux de sauvetage d'urgence" la protection en verre du tableau. Heureusement, l’œuvre est aujourd’hui restaurée.
L'année dernière, à pareille époque, je rappelais les bonnes questions que posait Marc Bélit dans un article du quotidien palois "La république",.
Rappelant que "l’école était là pour nous faire apprendre à connaître, la culture dira Malraux à nous apprendre à aimer - et ce qu’on aime, on le respecte -", le président de l’Académie de Béarn décelait dans la situation actuelle "qu’aujourd’hui, il n’est plus si certain qu’on apprenne le respect de la culture et de la beauté, mais bien plutôt le droit à la révolte".
Et à propos de ces vandales : "se doutent-ils, ceux-là, et leur a-t-on enseigné un jour que le Beau est la plus grande conquête de l’Occident ? Qu’il n’existe pas dans les autres cultures sinon par assimilation et par malentendu. Le beau est la forme que l’esprit de l’artiste impose à la matière et ainsi nous la rend visible dans l’œuvre. Par extension, il nous fait voir la nature comme une œuvre d’art. C’est cela et bien d’autre chose la culture, c’est cela qu’on a transmis de génération en génération depuis le monde grec.
Kant disait que le beau hante le monde sans s’y compromettre et Malraux encore lui que la culture ne s’hérite pas mais se conquiert. Il va sans dire que ce n’est pas avec une soupière à la main.
Tristes temps que les nôtres où l’on torture et l’on tue, et ou pour finir, on veut faire tomber les statues et défigurer les œuvres d’art.
Allons, ministres, enseignants et autres, réveillez-vous il est grand temps. La culture est la dernière façon de faire monde avec nos semblables en réapprenant à aimer ce que nous sommes et ce que nos artistes ont fait..."