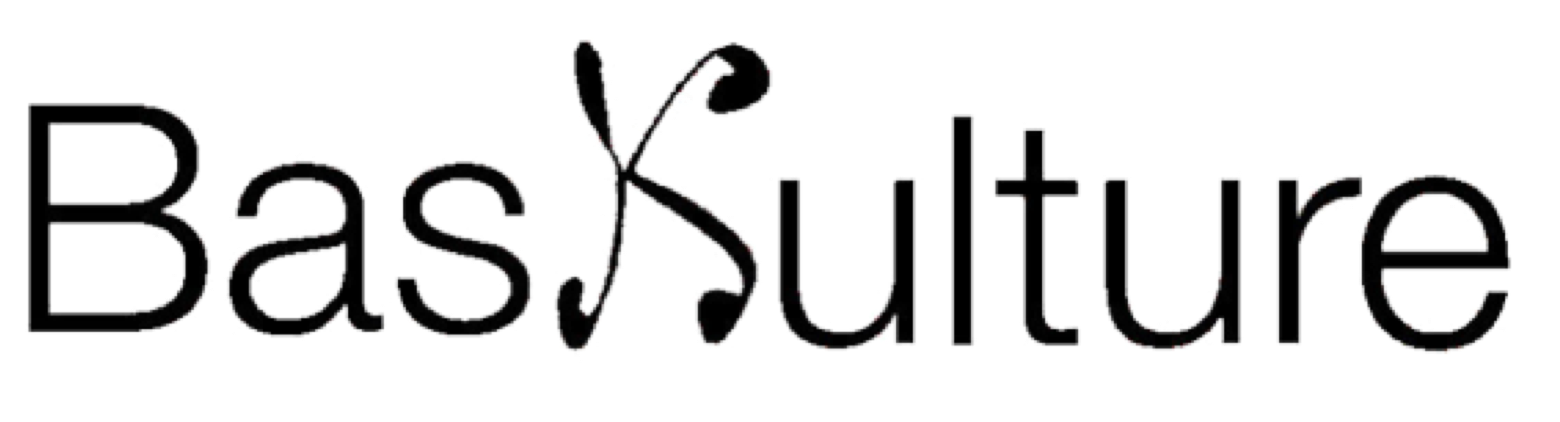Prix des Trois Couronnes : l'universitaire basque Eguzki Urteaga pour l'ensemble de son œuvre, en grande partie consacrée au Pays Basque.
Il y a bien longtemps, d'ailleurs, que le Prix littéraire des Trois couronnes aurait dû inclure dans son palmarès ce sociologue-historien qui a consacré tant d'écrits au Pays Basque, en matière linguistique, politique, sociologique et historique : son ouvrage sur les "Médias en Pays Basque" est particulièrement représentatif de la qualité et du caractère très complet de ses recherches, par exemple son étude remarquablement détaillée sur Radio-Adour-Navarre.
Chercheur associé au Centre de recherche sur la langue et les textes basques Iker, laboratoire du CNRS depuis 2003, l'année où il sera chargé de cours à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 et à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, Eguzki Urteaga est actuellement professeur de sociologie à l'université du Pays Basque de Vitoria-Gasteiz.
Lauréat de la Ville de Bayonne associée à Eusko Ikaskuntza, Eguzki Urteaga a présidé la section Iparralde / Pays Basque nord de la Société universitaire basque pendant plusieurs années en lui imprimant un dynamisme remarquable et en faisant coopérer plusieurs villes pour des actions communes, en particulier sous la forme d'attribution de bourses ou de prix.
Sérénité et objectivité sur fond de très grande réserve – voire même de pudeur - sont les qualités maîtresses de ce sympathique universitaire au visage ouvert qui s’anime à l’occasion d’un large sourire. Petit-neveu de l’organiste et compositeur luzien Juan Urteaga dont on appréciait la célèbre « Messe des Corsaires » qui pendant des années avait ouvert le Festival de Musique en côte basque, Eguzki Urteaga sait également s’abstraire de ses travaux universitaires en ayant parcouru l’Europe avec son épouse et pratiqué le golf à Chantaco ou s’adonner volontiers au cinéma, à la musique classique et au jazz,
Mais c’est bien l’écriture qui l’absorbe sans doute le plus. Outre les innombrables articles qu’il consacre à la langue et à la sociologie politique dans diverses revues ainsi que la publication de nombreux livres sur ces sujets, ses derniers ouvrages montrent volontiers une sociologie contemporaine en crise consécutivement à l'existence d'un décalage croissant entre la réalité sociale et sa représentation intellectuelle, dans la mesure où les théories, les concepts et les méthodes proposés par la sociologie permettent de moins en moins de comprendre la société dans sa complexité...
Parmi ses derniers livres, celui consacré à la pensée de deux auteurs contemporains, Zygmunt Bauman et Daniel Innerarity, à travers l’étude des œuvres de ces intellectuels qui n’hésitent pas à intervenir dans le débat public sur les principaux enjeux de notre temps : malgré leurs différences d’âge, d’origine géographique, de discipline, de trajectoires vitale et académique, ils partagent un même humanisme et une volonté résolue de s’attaquer, avec rigueur et lucidité, aux transformations profondes que connaissent les sociétés actuelles, sous l’effet conjugué de la globalisation, du libéralisme et de l’individualisme, ainsi qu’aux multiples crises, à la fois politiques, économiques, sociales, culturelles et sanitaires, auxquelles elles se heurtent.
En particulier Bauman sur "Le coût humain de la mondialisation", son livre paru chez Hachette dans lequel cet auteur d'origine juive-polonaise, pourtant acquis au communisme dans ses jeunes années avant de faire volte-face, estimait que loin d'apporter plus de confort et d'humanité à l'ensemble des habitants de la planète, la mondialisation les divise en deux camps : d'un côté une élite minoritaire, voyageant beaucoup, mondialisée, qui en tire tous les bénéfices, et de l'autre, une masse de plus en plus nombreuse d'exclus, de laissés-pour-compte immobilisés, fixés dans un espace restreint : la possibilité de se déplacer devient alors la principale source d'inégalité.
Pour ma part, j’ajouterai que certaines volontés – improprement qualifiées d’élites – nous poussent en fait tout droit vers ce que le génial Aldous Huxley désignait – il y a bientôt un siècle - comme le « meilleur des mondes » ou « Brave new world », du nom de son extraordinaire et prophétique roman où chaque individu est conçu par manipulation génétique, dans des flacons-éprouvette et conditionné à l’extrême pour appartenir à une classe sociale. (Alpha, bêta jusqu’à gamma).
Chacun suit alors sa vie toute prédestinée, dans un semblant de bonheur, et de plaisirs assouvies, sans se poser de questions. Dans cette société où tout est dévolu au bien-être et au confort matériel, il manque le concept de famille, la passion, la créativité et toute émotions qui y sont bannis.
Et c’est une espèce de gouvernement mondial très rétréci qui gère la planète… à part quelques « résistants », que l’on qualifierait volontiers actuellement d’extrême-qqchose, de complotiste ou que sais-je !
Visionnaire, Huxley estimait que « la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s’évader.
Un système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur servitude »...
Et dans « Retour au « meilleur des mondes » (Brave New World Revisited, paru en 1958), Huxley conclut que le monde avait évolué vers le pire à une vitesse bien supérieure que celle qu’il avait prévue. Le contrôle «par manipulation non violente des pensées des individus» était devenu une réalité par le truchement de la propagande, des idéologies, de la technologie et des mass médias.
Il souligne également les excès induits par le progrès technologique et par la concentration des pouvoirs économiques et médiatiques, la manipulation des individus par une réduction de la nuance au profit de slogans simples et lapidaires, etc.
Pour y faire face, Huxley préconisait le recours à l’éducation, seul rempart contre la manipulation, la passivité, les arguments simplistes et les dérives totalitaires.
Qu’eût-il dit de la situation actuelle, y compris dans nombre de nos universités ?
Pour en revenir à Zygmunt Bauman qui analyse les conséquences humaines de la mondialisation, il donne un sens et une cohérence aux phénomènes les plus remarquables du monde actuel : affaiblissement de l'Etat, primat de l'économique sur le politique, rôle des nouveaux médias, crises d'identité, etc. Cette dénonciation, virulente et impertinente des non-dits de la mondialisation dévoile le profond malaise des valeurs humanistes que nous traversons.
Une problématique qui nous interpelle, ainsi que – je pense – notre lauréat à qui nous avons grand plaisir d’attribuer ce prix très mérité – Beraz, milesker ainitz zuri, Eguzki, eta biba zu !