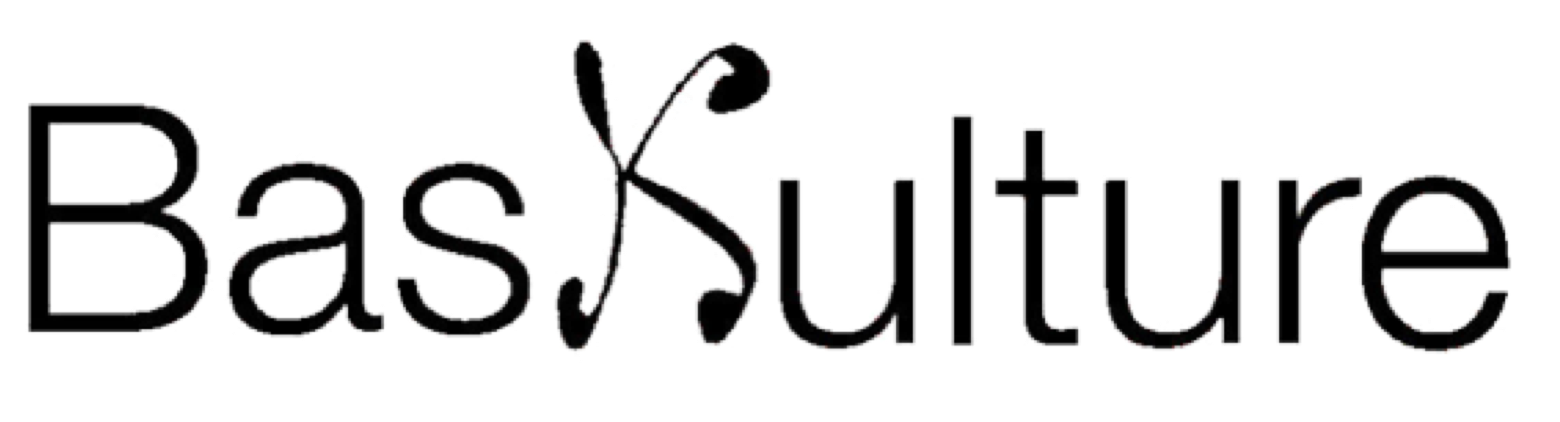« Lanquan li jorn son lonc en mai »… Ces jours qui sont longs en mai, comme le chante le troubadour Jaufré Rudel nous donnent l’occasion d’égrener quelques souvenirs à propos de ce rêve poétique de l’Amour courtois et du légendaire chevaleresque qui guidèrent dès l’origine la plume d’Edmond Rostand.


Et autour de l’hymne « Te Cantem Occitània » de Michel Fenasse-Amat, c’est un hymne à l’Occitanie toute entière, de la Gascogne au Piémont Italien, que nous découvrirons dans quelques instants avec des artistes de talent.
Pourrais-je y ajouter également l’ancien royaume de Navarre où j’habite, avec le roi Thibaut Ier surnommé le chansonnier pour ses nombreux poèmes courtois, d’amour et de croisades, même s’il était originaire de Champagne, donc de langue d’oïl, sans oublier les improvisateurs en langue basque, les bertsularis, qui dès le moyen-âge, chantaient les guerres, les disputes familiales, la mort d’un chef, la victoire sur l’ennemi, etc.
Ainsi que la Castille, en particulier mon ancêtre le roi Alphonse X le Sage, dont la Cour était peuplée de trobadors et de musiciens, et lui-même auteur des célèbres « Cantigas de Santa Maria », ce qui lui valut d’ailleurs le surnom de « trovador de Santa Maria ».
Et si la lutte était féroce contre les envahisseurs islamiques - son fils aîné, dont je descends, Fernando de La Cerda, mourut très jeune dans ces circonstances, en ayant toutefois laissé deux fils en bas âge pour assurer sa descendance – les registres de la Cour et des enluminures montrant des ménestrels révèlent un certain « œcuménisme » musical : tout en offrant un asile aux troubadours fuyant les persécutions islamiques d’Al Andalus – car en dehors de quelques très courtes et rares périodes, les chrétiens y étaient considérés comme « dhimmis » ou soumis, voir torturés et occis sans pitié s’ils refusaient de se convertir à l’islam – eh bien, pour en revenir à Alphonse X le Sage et à sa Cour de trobadors, lettrés, savants et musiciens, elle comptait non seulement des chrétiens, mais également des juifs et des maures utilisant entre autres des instruments venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, tels les « rabab », famille d’instruments à cordes, en réalité issus de l’Egypte antique et de la lyre des Byzantins – ainsi que « l’oud », instrument à cordes pincées, en réalité d'origine perse…
Mais poésie, musique et faits d’armes circulaient intensément entre royaumes chrétiens : on trouve ainsi sur une fresque de l’ancienne forteresse de Calatrava représentant le grand combat des chevaliers chrétiens contre les Sarrazins dans cette partie de Castilla-La Mancha, à la frontière avec l’Islam, Arnaut-Guilhem Ier, seigneur de Marsan, de Roquefort, de Montgaillard, de Cauna, de Saint-Loubouer..., et autres terres, connu pour être un troubadour de renom, auteur de l’Ensenhamen, guide des jeunes chevaliers, très apprécié d’Aliénor d’Aquitaine qui avait tenu à ce qu’il l’accompagne à la cour d’Espagne en 1170 pour le mariage de sa fille, une autre Aliénor ou Léonor, avec Alfonse de Castille, fils d’Alfonse VII, le vainqueur des Musulmans à Calatrava.
Arnaut-Guilhem Ier de Marsan était aussi très proche du fils d’Aliénor - elle-même fille d’un « duc-troubadour », Richard, futur Cœur-de-Lion, qui préférait le gascon de sa principauté d’Aquitaine à l’anglais de son royaume d’Angleterre : il avait été élevé à la cour de Poitiers, alors capitale de l’Aquitaine et brillant foyer de culture où se produisaient musiciens et troubadours, initiateurs d'un nouvel art de vivre fondé sur l'amour courtois. A leur école, Richard deviendra lui-même poète, les protégera et favorisera la diffusion de leurs œuvres.
Sans oublier non plus de mentionner mon autre ancêtre, Gaston Febus, le célèbre vicomte de Béarn, sorte de Roi-Soleil avant la lettre, surnom choisi en raison de la « chevelure de flamme » qui couronnait sa belle allure – si l’on en croit Froissard et les mémorialistes de l’époque - prince cultivé, héritier des princes troubadours occitans et devancier des princes de la Renaissance, portant une attention soutenue aux ménétriers, compositeurs, poètes, circulant sans cesse d'une cour à l'autre dans cette Europe de la fin du XIVème siècle. D’ailleurs, parmi ses œuvres qui nous sont parvenues, on peut citer une « canso » (si canti, you que canti, qui lui est attribuée), primée par le Consistoire de la Gaie Science, l'ancêtre de l'Académie des Jeux Floraux.
Et nous voici donc parvenus à cette extraordinaire institution qui constitue certes « la plus ancienne société littéraire vivante du monde civilisé ».
Près d'un siècle après la croisade contre les Albigeois qui avait mis à feu et à sang le Midi de la France, le mardi après la fête de la Toussaint de l'an de grâce 1323, sept notables de Toulouse se réunirent dans le verger appartenant aux religieuses de l'ordre de saint Augustin, dans le faubourg Saint-Aubin, pour y fonder la «Compagnie du gai savoir ».
Sous le nom « des 7 troubadours », l'histoire se souviendra de l’écuyer Bernat de Parnassac, du bourgeois Guilhem de Lobra, des changeurs Béringuier de Saint-Planquat et Peyre de Méjanessera, des marchands Guilhem de Gontaut et Peyre Camo, ainsi que du notaire Bernat d'Oth. Ils firent appel à tous les Trouvères et Ménestrels du Midi pour participer à un concours de poésie en ces termes :
Als honorables e as pros
Senhors, amis e companhos,
Asquals, es donat le saber
Don creish als bos gaug e plazers,
Sens e valor, e cortesia,
La sobre gaïa companhia
Dels set trobadors, de Tolosa,
Aux honorables seigneurs et amis, compagnons qui possèdent la science mère de la joie, le plaisir, le bon sens, le mérite, la courtoisie ; la très gaie compagnie des sept troubadours de Toulouse, salut et joyeuse vie (...) Et pour que chacun mette tous ses soins dans la composition de ses poèmes, nous promettons de donner, par un jugement équitable, une violette d'or fin, pour marque d'honneur au meilleur ouvrage : nous n'aurons aucun égard ni à la position, ni à la naissance du poète : notre choix sera déterminé par la beauté des vers.
La joute fut fixée au premier mai et la remise du prix le 3 mai de l'année suivante. C'est cette date du 3 mai qui se perpétuera donc à travers les siècles jusqu’à nos jours, sans autre interruption que celle de la période révolutionnaire, Napoléon rétablissant les académies en 1806.
Plus tard, deux autres prix viendront s'ajouter à la violette d'or : un souci d'argent et une églantine d'or, récompenses consenties par les Capitouls toulousains soucieux de développer les arts dans le Languedoc.
Les « Présidents de la Compagnie du gai savoir » prennent alors le nom de « mainteneurs » chargés du maintien de la gaie-science et Guillaume Molinier, chancelier de la compagnie, est chargé de la rédaction des « Leys d'amor », les lois d'amour où se trouvent codifiées la métrique, la grammaire et la rhétorique du Moyen Age d'oc. Les manuscrits en sont conservés dans les archives de notre Académie, ainsi que ceux des recueils d'œuvres couronnées par les Mainteneurs aux quatorzième et quinzième siècles.
En 1515, les mainteneurs changent le nom de leur société en « Compagnie des Jeux Floraux ».
Or, dans l'Histoire de Toulouse, les origines des jeux Floraux ne semblent pas séparables du mystérieux souvenir de Dama Clémensa, considérée comme inspiratrice et bienfaitrice des poètes. Au dernier tiers du XVe siècle un savant jurisconsulte de la Renaissance, Guillaume Benoît, vise expressément dans son cours sur les testaments, professé à Toulouse, le legs fait à la Ville par « cette illustre Dame Clémence », à charge pour elle de distribuer périodiquement des « fleurs d'argent pour exciter la jeunesse à l'éloquence ».
Mais la figure de Clémence Isaure ne prendra consistance qu'avec les écrits des juristes et humanistes du XVIe siècle, d'Etienne Dolet à Jean Bodin. Pour justifier cette nouvelle dénomination patronymique - qui reste douteuse du point de vue historique - une statue tombale du siècle précédent, image d'une dame de la famille des Ysalguier sera, vers 1540, transportée et érigée au Capitole où désormais le Consistoire tenait ses assises, et bientôt pourvue des attributs du Gai Savoir. Cette statue se trouve maintenant en l'Hôtel d'Assézat, présidant les séances publiques de l'Académie.
Depuis 1527 l'éloge de « Clémence Isaure » est, chaque année, prononcé en la fête du 3 mai.
Au seizième siècle, la Compagnie, qui avait le nom de Collège de Rhétorique, admit à ses concours la langue française, qui bientôt s'imposa de façon exclusive. L'institution fut attentive au mouvement de la Pléiade, honora de ses dons Ronsard, Lazare de Baïf et couronna le dramaturge Robert Garnier.
En septembre 1694, par Lettre patentes octroyées à Fontainebleau, Louis XIV, considérant l'ancienneté de la Compagnie, « l'émulation qu'elle a toujours inspirée aux meilleurs esprits des provinces de Languedoc et de Guienne » et sa réputation « étendue depuis plus de trois siècles chez les étrangers », l'érigea en Académie, porta le nombre des Mainteneurs à trente-six et définit ses statuts.
C’est à cette époque, d’ailleurs, que remontent les premières nominations de Maîtres ès jeux, destinés à seconder le jugement des concours littéraires ainsi que leur rayonnement. Cette adjonction de poètes ayant triomphé aux jeux apportait une sensibilité différente et bénéfique ; d'autre part, des choix souvent faits en dehors de la proche région toulousaine fournissaient à l’Académie des points de vue distincts, en même temps qu'ils assuraient une diffusion élargie de sa réputation.
En 1773, par l'Edit de Compiègne, Louis XV confirma les privilèges qu'avait accordés son aïeul et porta le nombre des Mainteneurs à quarante.
Aux abords de la Révolution, un roman de Florian popularisa la légende de « Clémence Isaure » en laquelle les érudits de la période romantique, à la suite de Dumège, voulurent découvrir une incarnation de la poésie mystique des troubadours.
Et nous avons énuméré précédemment quelques-uns des noms illustres qui en firent partie au XIXe et au XXe siècle.
En 1895, remontant à sa plus lointaine tradition, sur les instances de Mistral qu'elle avait appelé à elle vingt ans plus tôt, l'Académie redevint bilingue et admit à son concours, conjointement avec le français, tous les dialectes d'Oc.
Cette même année, la libéralité d'un mécène, Théodore Ozenne, lui attribua pour logis l'Hôtel d'Assézat, somptueux palais de style Renaissance, en pierre et en brique, bâti à la fin du XVIe siècle par un riche négociant en pastel, où a pris place désormais l'effigie de Clémence Isaure dont la renommée, notons le pour l’anecdote, s’étend jusqu’à Biarritz et bien sûr au-delà.
Car, curieusement, dans la villégiature préférée d’Eugénie, se trouve une « Villa Isauria » qui appartient toujours aux descendants de Louis Lacroix, mainteneur et bienfaiteur de l’Académie, dont la famille avait acquis cette grande et belle maison au début du XXème siècle. Attenante à l’église russe, elle recèle toujours dans son salon l’effigie de Dame Clémence !
Reconnue d'utilité publique en 1923, l'Académie continue de nos jours à maintenir ses traditions originelles depuis sept siècles. Entré moi-même il y a 25 ans dans cette illustre compagnie, j’y ai connu beaucoup d’écrivains dont certains sont aussi membres de l’Institut de France ou majoraux du Félibrige, des personnalités tels le Grand-Maître de l’Ordre de Malte et le prince consort Henrik de Danemark, également auteur de recueils poétiques ; le juriste Roger Merle, le pilote d’essai André Turcat, le prix Nobel de médecine Jean Dausset, de nombreux universitaires parmi lesquels l’hispaniste Bartolomé Bennassar, des représentants d’anciennes familles comme le duc de Lévis-Mirepoix qui s’intéressa particulièrement aux « Troubadours d'Hier et d'Aujourd'hui » et le comte Guillaume de Toulouse-Lautrec, dont l’arrière-grand-père, Raymond de Toulouse-Lautrec, qui y siégea de 1845 à 1890, avait participé aux premiers développements du Félibrige : son intimité avec Frédéric Mistral fit accepter en 1878 au futur prix Nobel de littérature (l’un des rares accordés à un écrivain dans une langue - il s'agit du provençal - non reconnue officiellement par l'État auquel il appartient administrativement parlant) - qui fit donc accepter à Mistral son entrée à l’Académie des Jeux Floraux où il mentionna en provençal ces « rois troubadours et troubadours rois qui au parler toulousain donnèrent pour frontière tous les versants méridionaux et tous les rivages où l’amour fait loi.
C’est vous qui êtes l’idée, c’est vous qui êtes le signe
Brillant sur le front des peuples où vous régnez
Et tout ce qui est pieux, noble, auturen, insigne,
Et tout ce que l’on veut que le poète enseigne,
C’est vous qui l’enseignez. »
Ainsi, à l’image de ses fondateurs, les sept troubadours qui avaient lancé cet appel en 1323, les Jeux Floraux prétendent s’inscrire dans l’héritage « des troubadours du temps passé / qui avaient en jouissance / un lieu merveilleux et beau / où sont récités maints dits nouveaux / avec l’aide du Dieu d’Amour ». Sous l’égide de cette « dame de très noble nature / avenante plaisante et belle / couronne porte sur la tête / ornée de très grandes vertus / et elle est intitulée Amour / Elle est libérale et récompense / son fin aimant et lui donne / une violette d’or fin ».
Rêve poétique de l’Amour courtois et esprit chevaleresque que la plume d’Edmond Rostand imprimait naturellement à « la cire » de ses héros, de Jaufré Rudel à Cyrano. N’était-il pas dès sa jeunesse « pétri » de cet idéal inclus dans son étude « Deux romanciers de Provence : Honoré d’Urfé et Emile Zola » qui lui avait valu sa première récompense littéraire octroyée par l’Académie de Marseille ? Il y écrivait : « (…) en cette Provence amoureuse de l’Amour (c’est chez elle qu’il a tenu des Cours célèbres), et qui aime tout ce qui en parle, où jadis, dans les manoirs seigneuriaux, on attendait impatiemment la venue chaque nouvel an, avec la saison des violettes, du Troubadour, ce romancier voyageur »…
Cours d’amour provençales instituées, entre autre, à Orgon, berceau de la famille Rostand.
Et comme dans sa pièce précédente, « Les Romanesques », selon les indications de Rostand, sa « Princesse lointaine » traite de l’éternel conflit entre le rêve et la réalité.
Rappelons-en brièvement l’argument : Jaufré (ou Joffroy) Rudel, seigneur de Blaye et troubadour aquitain, a tant chanté la beauté légendaire de la princesse de Tripoli, Mélissinde, qu’il en est tombé amoureux. Sentant sa dernière heure venir, il veut enfin la rencontrer et organise une expédition, accompagné de son fidèle ami Bertrand d’Alamanon, troubadour de Provence.
Le navire arrive près de Tripoli mais Joffroy est trop faible pour aller à la rencontre de Mélissinde. Il charge Bertrand de la convaincre de venir à son chevet. Bertrand réussit à pénétrer dans le palais. Mélissinde en le voyant est persuadée qu’il est Joffroy Rudel, dont elle connaît les poèmes et la chanson de la Princesse lointaine. Elle en tombe follement amoureuse. Bertrand, également sous le charme, lui transmet le message de Joffroy Rudel mais Mélissinde refuse d’aller le voir et persuade Bertrand de rester avec elle. Le remords peu à peu les ronge et ils décident de se rendre auprès du mourant. Mélissinde se rend compte que c’est Joffroy Rudel qu’elle aime.
Or, si cette pièce est moins connue de nos jours, il est difficile de s’imaginer son retentissement à l’étranger. Par exemple, à Moscou, la façade du célèbre hôtel « Métropole » a gardé jusqu’à nos jours la mosaïque de Mikhaïl Vrubel « Princessa Gryoza » (ou la princesse des songes) réalisée d’après la fresque que le génial artiste de l’« Art Moderne » avait conçue pour la Foire internationale de Nijny Novgorod d’après « La Princesse lointaine », l’année même de la création de la pièce d’Edmond Rostand en 1895.
Ainsi, lorsqu’il y a 25 ans, j’eus moi-même l’honneur d’être élu au sein de cet antique et illustre cénacle littéraire, ce qui aiguisa davantage encore ma curiosité des circonstances dans lesquelles l’auteur de « L’Aiglon » y était entré, je commençais par éplucher le recueil de 1898 et ceux des années postérieures pour trouver une quelconque mention de l’événement, la remise du diplôme ou « lettres de maîtrise » donnant lieu habituellement à un discours de félicitations suivi des remerciements du récipiendaire. Rien !
Je compulsais parallèlement les recueils des années antérieures afin de trouver quelque envoi de poésie d’Edmond Rostand que l’Académie aurait pu primer : pas davantage de trace.
J’orientais alors mes recherches vers les registres de délibérations où pareille décision des académiciens aurait pu être consignée, hélas sans succès. Finalement, c’est dans le compte rendu de la séance du 3 mai 1898, rédigé d’une écriture fine et appliquée, que je découvris l’objet de ma quête. Il y était indiqué : « Le modérateur annonce à l’assemblée qu’en vertu de ses statuts réglementaires (titre premier, article 5), l’Académie ayant jugé à propos d’octroyer des lettres de maîtrise à l’auteur, si justement applaudi et fêté, de « Cyrano de Bergerac », que Monsieur Edmond de Rostand les a acceptées avec reconnaissance, sous la promesse de prendre, l’an prochain, une part active à la solennité du trois mai ».
Indiquons encore que parmi ces Maître ès Jeux Floraux, on trouve également des écrivains que Rostand a côtoyés ou dont il s’est inspiré, tel Camille Chabaneau, auteur des « Biographies des Troubadours » - pour l’épopée de Jaufré Rudel dans « La Princesse lointaine ».
N’oublions pas non plus Henry de Gorsse, « son aîné de onze jours qui devait être le camarade de tous ses jeux d’enfant, le confident de tous ses projets d’adolescent et, jusqu’à son dernier jour, son ami le plus fraternel et le plus sûr » selon la belle formule de son petit-fils Pierre de Gorsse qui fut secrétaire perpétuel de l’Académie des Jeux floraux et fondateur d’un prix littéraire dont j’ai d’ailleurs eu l’honneur d’être lauréat.
On peut encore citer, plus près de nous, des talents aussi divers que François Coppée, René Bazin, et Jean Suberville, ce mitrailleur-poète dans les tranchées de la guerre de 14-18, auteur de « Cyrano dans les tranchées » que j’avais évoqué vendredi (pour ceux qui avaient assisté à la remise du Prix littéraire des Trois Couronnes), et à qui Edmond Rostand, enthousiaste, avait envoyé cette lettre :
"Mon cher poète et mitrailleur,
Je vous remercie de m'avoir envoyé votre acte vibrant, pittoresque, et plein de mouvement ; vos rimes crépitent comme vos balles, le vers passe comme un ruban de cartouches ! et il m’est bien doux que ce Cyrano des Tranchées ait été joué sur un théâtre Chanteclair, au front. Double souvenir dont je suis plus fier que je ne saurais le dire ! Etre un petit peu dans vos cœurs héroïques, si humble que soit mon cœur, voilà qui me réconforte et me donne la force de supporter vos épreuves, vos dangers, d’attendre votre retour victorieux… Croyez, mon cher poète, vous et vos camarades, à mon admiration fervente, à ma reconnaissance de tous les instants.
Votre Edmond Rostand
Paris. 28 mars 1918"
Mais puisque nous évoquons 14-18, comment ne pas mentionner un lauréat des Jeux Floraux qui, lui, périt dans les tranchées à Verdun : il s’agit d’Angely Andrieu, ce jeune Varennois, également poète reconnu, qui est le grand-oncle de l’artiste que vous entendrez dans quelques instants : Marie-Ange Bouzinhac de Lacaze, chanteuse et poétesse occitane, qui avait reçu la fleur de l'Académie des Jeux floraux pour son 7ème centenaire, en 2023.
Dans son Discours de Réception à l’Académie Française, Rostand souhaitait “un théâtre où, exaltant avec du lyrisme, moralisant avec de la beauté, consolant avec de la grâce, les poètes, sans le faire exprès, donnent des leçons d’âme”.
Et en guise d’épilogue, permettez-moi de citer cette strophe écrite par Edmond Rostand à l’intention des élèves du collège Stanislas, qu’il avait fréquenté en classe de rhétorique :
« Monsieur de Bergerac est mort. Je le regrette.
Ceux qui l’imiteraient seraient originaux.
C’est la grâce, aujourd’hui, qu’à tous je vous souhaite.
Voilà mon conseil de poète :
Soyez des petits Cyrano. »
Palsambleu, ajouterai-je ! Et maintenant écoutons nos merveilleux artistes !