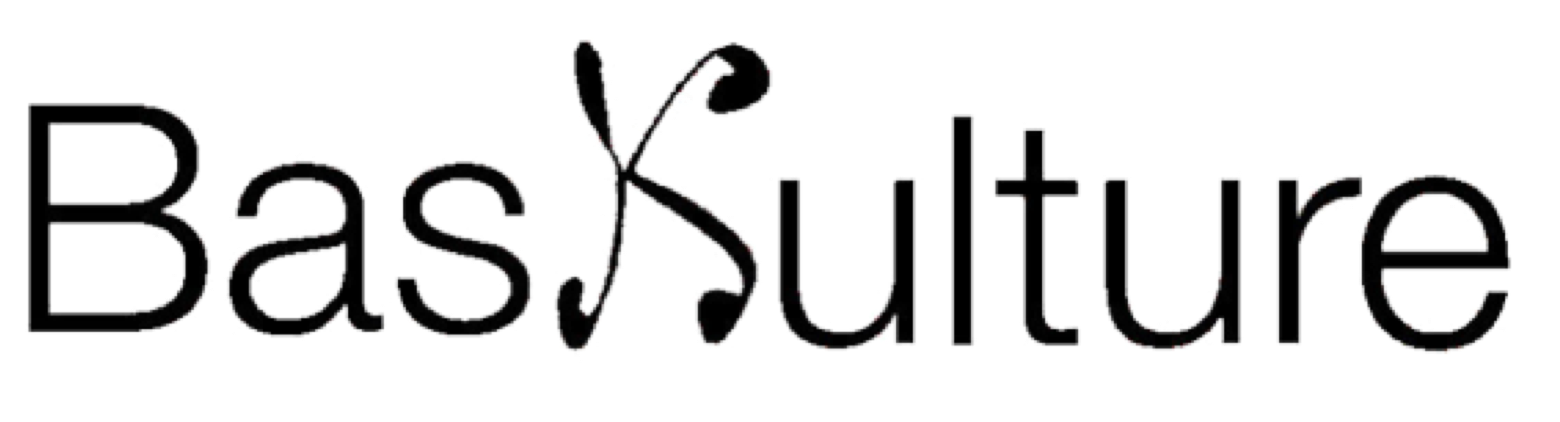Nous fûmes pour quelques uns les enfants de la guerre. D'un père STO ou en Occupation en Allemagne et d'une mère fermière ou ouvrière ayant porté les fermes et les ateliers en l'absence de leur père ou mari pour certains.
De grand père venu du Front de la grande guerre et qui souvent prit sa place dans l'éducation de ses petits enfants auprès de nos parents surchargés des besognes de la ferme, à la main sans autres outils que des bras et des jambes à la merci du quotidien agricole.
La scolarité de ces enfants bascophones en des écoles laïques ou publiques disait-on en ces années pour les distinguer des écoles des curés ou des nonnes, cohabitaient en bien des villages, ou en certains comme le mien la laïque avait le privilège seul de régner en quatre écoles de quartier sans concurrence religieuse quelconque.
On parlait basque à la maison et le parler en question était interdit à l' école par l'instituteur ou l'institutrice maitre et maitresse à la fois, les garçons confiés au maitre, et les filles à maitresse.
La pratique des sanctions au coin de la classe, de la règle sur les doigts juvéniles de l'enfant, ou la mise en cachot sous le bureau du maitre en punition étaient monnaie courante et les sanctions convenues et "bien adoptées" par les parents pour qui la réputation de la famille prévalait sur ces diversions du maitre d'école.Maitre et maitresse étaient de vieux soldats de la guerre, de la résistance et se formalisaient peu des convenances à quelques années à peine de la fin d'un épisode historique encore présent dans les esprits !
Une relation de confiance existait entre les parents et les maitres et maitresses, on portait quelques oeufs de ferme ou de fromage à maitresse pour lui dire notre gratitude familiale, on lui portait le bois de chauffage, car la malheureuse disposait d'un confort sommaire dans un studio aujourd'hui F1 sans fioriture.
On rétribuait de la sorte en nature maitresse ou maitre qui ne rechignait à recevoir ces prébendes toutes inspirées des pratiques religieuses des clercs de la maison d'en face. Le curé du village habitué de ces usages comme maitre ou maitresse, et reconnu dans sa fonction prestigieuse. Apprendre à des petits basques analphabètes à lire écrire compter en français, sachant au demeurant qu'ils savaient le faire en basque mais n'en disposaient du droit reconnu par les autorités scolaires de ce temps.
La maitresse arborait comme son collègue un tablier boutonné du haut en bas digne de quelque soutanelle inspirée somme toute des vêtures cléricales. Enseignants, prêtres ou religieuses portaient l'uniforme des hussards plutôt noirs d'époque. Les maitresses en Marianne de la république disposaient d'une chevelure abondante tressée sur des centimètres et attachée sur la tête en couronne républicaine comme reproduits en des bustes d'époque.
On avait beaucoup appris de l'école d'en face, confessionnelle des uns, laïque des autres, et le charme de cette époque était d'en avoir connu les ressorts de l'une et de l'autre sans s'outrager outre mesure des méthodes acquises pour instruire les enfants, à l'époque on parlait d'instruction publique. L'éducation nationale viendra plus tard !
L'amusement était à son comble quand l'enfant adolescent turbulent traversait comme à Bayonne l'école des soeurs ou l'inverse pour rejoindre l'école des instituteurs institutrices, maitres ou maitresses d'enseignement. Le renvoi en était le motif et la cause disputée ou discutée en deux cénacles distincts. On oubliait sans doute que des relations de courtoisie républicaine ou cléricale existaient entre ces institutions sans confusion, ni contusion ni compromission.
On pouvait se raconter à la maison les nouvelles d'en face sur les disciplines scolaires, les avis et humeurs des enseignants, ou la colonne des punitions imposées jusqu'aux claques, corrections ou sanctions physiques admises et par les instits et les parents. Dans les deux écoles, la laïque et la privée on ne connaissait pas d'autre ressource éducative in diraient les contemporains que nous sommes.
On disait dans l'opinion que telle école était bonne pour l'enfant, le cancre ou celui qu'il fallait dresser par défaut. Les écoles publiques comme les confessionnelles, laïques ou privées, en langage d'époque adoptaient les mêmes sanctions sans distinguer les situations.
Il n'y avait plus de " bagnes" de correction à proprement parler mais pour ces anciens soldats de 45 reconduits dans les écoles comme maitres d'autorité et de réputation, le recrutement des uns se faisait ainsi selon des critères qui seraient aujourd'hui punissables. Mais par qui ? Les autorités académiques, les parents, les maitres ou maitresses ? Un certain flou demeure en la matière. L'appartenance de l'enfant à la nation, à la famille ou aux maitres le temps des études se posait déjà mais la réponse se ferait attendre !
La réputation d'une école était consacrée au directeur ou directrice laïque ou religieuse qu'importe !
On ne tarissait d'éloges pour les résultats scolaires acquis chez nous en pays basque, de certificats d'études et de brevets puis des formations professionnelles pour la plupart. Les méthodes disciplinaires employées semblaient de peu de rapport à l'époque sur les avancements scolaires obtenus.
Ceux qui aujourd'hui refont l'histoire, relisent le passé à l'aune du présent, jugent leurs ainés maitres ou maitresses, prêtres ou nonnes enseignants avec légèreté, devraient leur destiner une gratitude postérieure. Nombre d'enfants des deux sexes acquirent en quelques décennies la connaissance de l'enseignement en français, chez des analphabètes premiers, capables d'assimiler en peu de temps ce que nos grands parents n'avaient pu obtenir dans leur enfance.
Issus de cette école d'après guerre de 45 s'entend, nous ne connaissions ni TV, ni radio ni téléphone dans nos maisons, un journal quotidien en basque, le français des républicains se faisait désirer encore, et l'information circulait à la sortie des églises le dimanche, ou des marchés hebdomadaires qui fleurissaient dans le paysage des chefs lieux de cantons, partout dans le département.
Les nouvelles étaient fraiches dans la huitaine l'immédiateté des informations, ou leur instantanéité n'était pas d'urgence nécessaire. Le travail manuel à la ferme occupait le temps et bien souvent les enfants que nous fûmes.
Après classe il y avait la traite des vaches ou des brebis à la main. La surveillance des troupeaux en prairie, le déplacement des bêtes de prairie en une autre faisaient de nous des garçons de ferme, en vrai et non en apparence.
La guerre avait façonné nos parents, maitres et maitresses dans un spectre rude et résistant. Nos générations n'en furent épargnées, car la discipline étant la force des armées, les chérubins venus à terme dès la fin de cet engagement guerrier en Europe, on nous donna dans l'urgence des outils premiers d'acquérir le goût de la liberté, de la fraternité du vivre ensemble, et de la patrie qui furent bien bouleversées en ces temps. Sont-elles assurées aujourd'hui de notre avenir ? L'adversité entretenue dans les médias, les institutions, les instances régaliennes du pays ne joue en la faveur d'aucune d'elles, l'école, la famille, le monde du travail, en somme le pays.
Faire le procès du passé n'enrichit que de peu la mémoire en faveur du présent.