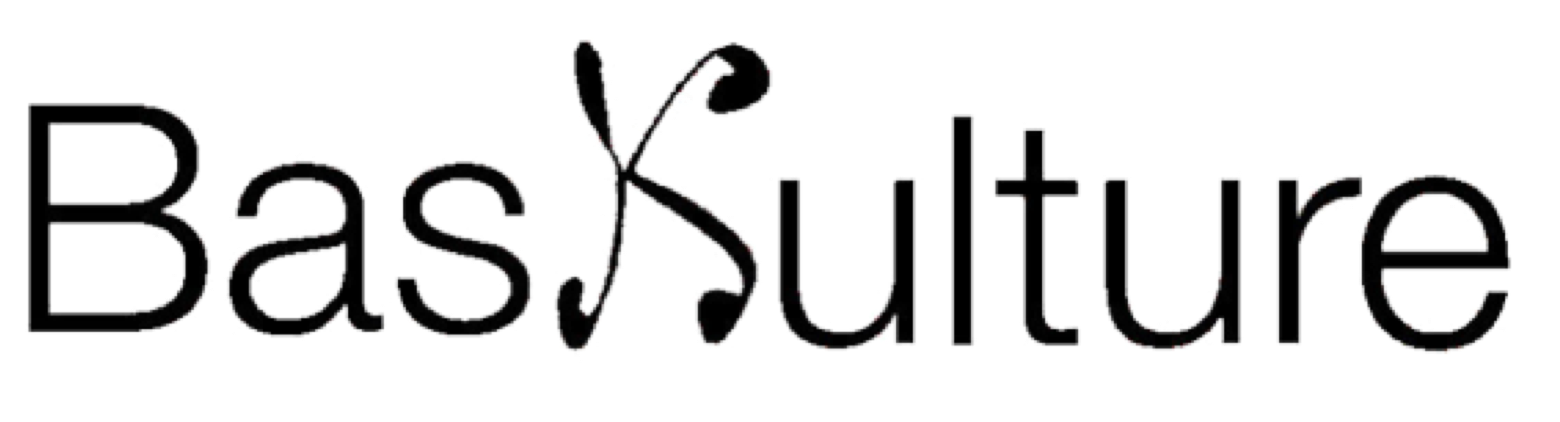« Billie » - Film américain de James Erskine – 92’
Eleanora Harris Fagan, née en avril 1915, est une chanteuse américaine de blues et de jazz connue sous le nom de scène de Billie Holiday. Avec Ella Fitzgerald (1917/1996), Sarah Vaugham (1924/1990) et Nina Simone (1933/2003), elle est une des représentantes du Jazz vocal des années 1940/1960. Sa vie chaotique, cabossée, démarre sous les pires auspices : sa mère Sarah Julia « Sadie » Harris qui se faisait aussi appeler Sadie Fagan, nom d’ascendance irlandaise (grand-père maternel), la met au monde à 13 ans. Son père Clarence Holiday, musicien professionnel (guitariste de jazz) est âgé de 15 ans. Ses parents ne seront jamais mariés malgré les assertions de Billie dans son autobiographie (Lady Sings the Blues - 1956). Sa mère mène une vie dissolue et se prostitue à l’occasion. La petite fille est prise en charge, tant bien que mal, par la famille de sa mère. Elle est placée dans des maisons de redressement pour jeunes noirs. Là, elle sera confrontée, gamine, à la violence et au viol. Elle en sort meurtrie à jamais.
A 13 ans, en 1928, Billie s’installe avec sa mère à New-York. Elle chante du jazz à l’occasion dans des petits clubs et des « speakeasies » (bars clandestins durant la prohibition) et comme sa mère se prostitue à l’occasion. En 1933, John H. Hammond (1910/1987), musicien, critique et producteur de la firme Columbia la découvre dans un club. Séduit par cette jeune chanteuse de 18 ans à la diction et à la voix rauque étonnante, il lui propose un enregistrement avec un jeune musicien plein d’avenir : le clarinettiste Benny Goodman (1909/1986). L’année suivante elle chante dans l’orchestre de Bobby Henderson (1910/1969) à l’Appolo Theater (Harlem) salle mythique, symbole de la musique noire américaine. Sa carrière s’envole. Elle rencontre les grands musiciens de jazz de ces années : Lester Willis Young (1909/1959), saxophoniste, clarinettiste et compositeur, qui sera l’ami de toute une vie et qu’elle surnomme Président, puis Prez. En retour Lester W. Young la surnommera Lady Day surnom qui perdurera. Elle côtoie tous les grands jazzmen des années 1930/1940 tels que : Duke Ellington (1899/1974), compositeur, pianiste et chef d’orchestre, Teddy Wilson (1912/1986) pianiste, John Kirby (1908/1952) contrebassiste, Cozy Cole (1909/1981) batteur, etc.
Billie Holiday devient l’une des vedettes du jazz new-yorkais et se hisse au niveau de l’autre grande interprète noire, Bessie Smith (1894/1937), au style différent. Elle devient chanteuse d’orchestre (noir) pour Count Basie (1904/1984) et d’un orchestre blanc, celui fort renommé du clarinettiste Artie Shaw (1910/2004). Lors d’une tournée dans les états du sud les musiciens de l’orchestre dorment à l’hôtel et Billie dans le bus les noirs n’étant pas accepté dans ces établissements. Bien que vedette, pour monter sur scène elle passe par les cuisines : c’est la ségrégation selon « les lois Jim Crow (1870/1964) » appliquées dans les états du sud selon lesquelles les deux communautés, blanche et noire, vivent séparées. Paradoxalement on ne la trouve pas assez noire (ascendance irlandaise !) et parfois on insiste pour qu’elle se grime en plus foncé afin de correspondre aux stéréotypes ! Soumise à un racisme permanent, elle met fin à sa tournée par ailleurs triomphale (ce thème a été traité dans le film américain Green Book : sur les routes du sud de Peter Farrelly – 2018).
Rentrée à New-York, Billie Holiday continue à chanter dans les clubs grâce à John H. Hammond qui lui trouve des engagements notamment au légendaire club de jazz Café Society. En 1939, elle crée sa chanson fétiche Strange Fruit de Lewis Allan (pseudonyme d’Abel Meeropol) métaphore du lynchage de noirs, pendus à un arbre, se balançant dans la brise du Sud.
Billie Holiday tout en menant une vie chaotique sur le plan sentimental (bisexuelle assumée), grande buveuse, droguée à toutes sortes de substances, rencontre lors de ses multiples enregistrements la crème des musiciens de jazz de son temps : Roy Eldridge (1911/1989) trompettiste et chanteur, Art Tatum (1909/1956) pianiste virtuose, Benny Carter (1907/2003) multiinstrumentiste, Dizzy Gillespie (1917/1993) trompettiste et chef d’orchestre, etc. D’une santé précaire qu’elle aggrave avec ses abus d’alcool, de drogues diverses, de médicaments pour y remédier, elle s’éteint après moult rechutes en juillet 1959 à l’âge de 44 ans.
A la fin des années 60, la journaliste new-yorkaise Linda Lipnack Kuehl, fascinée par la personnalité de Billie Holiday, travaille sur une biographie de l’artiste. Sur son petit magnétophone portable, elle recueille 200 heures de témoignages sur les personnalités, artistes ou non, qui ont connu Billie : Count Basie, Tony Bennett (1926) chanteur, Charles Mingus (1922/1979) contrebassiste, Sylvia Syms (1934) actrice britannique, ses amants, ses proxénètes, ses avocats et mêmes les agents du FBI qui l’ont pourchassée et arrêtée. Linda Lipnack Kuel n’écrira jamais la biographie officielle de Billie Holiday : son corps est découvert en février 1978 dans une rue de Washington D.C. Une mort mystérieuse inexpliquée, par défenestration. C’est à partir de ces matériaux sonores (125 cassettes audio !) que le documentariste James Erskine va structurer son long métrage. Avec ceux-ci comme soubassement audio, il monte des bandes d’actualités (noir et blanc) et de quelques passages à la télévision alors naissante au États Unis et en Angleterre. De surcroît, le réalisateur va travailler un montage serré en y insérant les nombreux clichés (noir et blanc puis couleur) pris durant la courte existence de la chanteuse. Les matériaux disponibles visuels (vidéos et photos) et sonores (cinéma, télévision, cassettes) étant fort disparates, James Erskine a créé l’unicité visuelle de son film grâce à la collaboration de la brésilienne Marina Amaral qui a colorisé les séquences vidéo d’une manière subtile, ce qui est peu aisé, compte tenu de la disparité des sources réparties sur une trentaine d’année.
Ce travail remarquable, très au-dessus du niveau habituel (voir les consternantes colorisations d’anciens films ou de bandes d’actualités) est renforcé par le « point de vue » adopté par le maître d’œuvre : le film déroule sans heurt, chronologiquement, la vie de l’artiste tout en la croisant avec celle, brutalement interrompue, de sa biographe Linda Lipnack Kuehl. Deux existences courtes, rompues, gâchées. Le résultat du mix images/sons est remarquable et d’une grande fluidité narrative tout en évitant de créer un parallèle systémique entre l’artiste (largement avantagée) et la journaliste en quête de vérité qu’elle ne recouvrera jamais.
Nous avons par le passé affirmé notre méfiance pour le genre documentaire qu’Agnès Varda appelait non sans malice, « documenteur ». Ce genre soi-disant « objectif » est souvent l’objet de manipulations (visuelles, sonores ou les deux cumulés) assez faciles au demeurant, et qui le seront de plus en plus. C’est pourquoi nous préférons employer le terme de « fiction documentée » comme il existe une musique « historiquement documentée » (musiques baroques jouées sur instruments anciens) mais dont on sait qu’elle ne sonnera jamais comme l’original (diapason, restauration des instruments, etc.).
Billie (92’) de James Erskine est un film en tout point remarquable, qui élargit le public des passionnés de jazz, d’autant qu’on y entend Billie Holiday, une chanteuse à la diction claire (une rareté de nos jours !), au timbre si particulier (vibrato) et au destin tragique dans une « Amérique Blanche ».