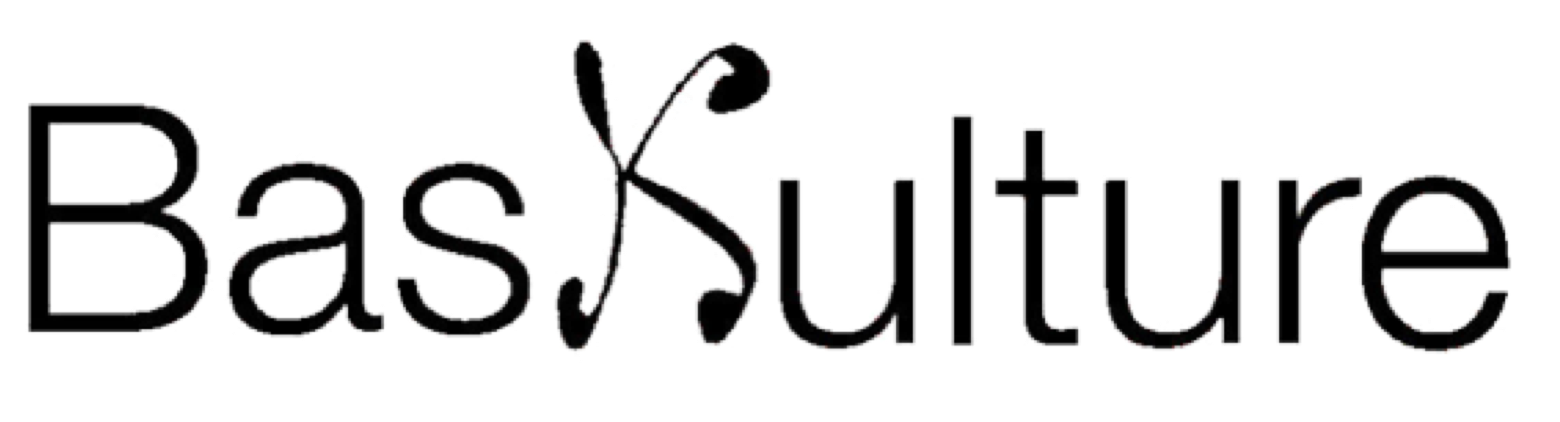"Euskaldun eta fededun", basque et croyante, c'est la précision que s'empressait d'apporter Maite Maniort-Hennebutte au début de son entretien pour le site "Mintzoak"... Et c’est avec une grande tristesse que j’ai appris sa disparition à l’âge de 95 ans. J’étais allé lui rendre visite plus d’une fois dans sa maison légèrement en retrait de l’avenue Kennedy, en particulier lorsqu’elle avait perdu – en juin 1999 – son mari Georges Hennebutte. L’occasion de revenir sur ces deux extraordinaires destinées biarrotes !


Maite Maniort est née à Neuilly le 3 avril 1930, son père (ingénieur biarrot) et sa mère (née Eliçabide, originaire du quartier Ibarron de Saint-Pée-sur-Nivelle) ayant pour des raisons professionnelles émigré vers la capitale. Après avoir suivi de 1935 à 1947 les cours de l'école libre Charles de Foucauld pour obtenir la première partie du baccalauréat, elle passa la seconde partie (bac philo) au cours secondaire des jeunes filles de Neuilly (annexe du lycée Pasteur) et l’obtint en juin 1948 avant d'entamer des études de droit à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne (1948-1953) et passer l’examen pour être avocate en octobre 1953, inscrite au barreau de Paris en novembre de la même année.
Après être restée stagiaire puis collaboratrice de Maître Boitard de 1953 jusqu’en 1960, année où elle suivra ses parents de retour au Pays Basque à la retraite de son père, Maite Maniort s’inscrira dès lors au Barreau de Bayonne et exercera son métier d’avocat jusqu’en 2006.
Mais en réalité, déjà à Paris, Maite Maniort manifestait une sensibilité basque affirmée : elle y avait rencontré un confrère originaire de Licq-Athérey : « il ne fallait pas attaquer les Basques devant moi parce que je répondais ! ». Elle participait ainsi aux Aberri Eguna (journée de la patrie basque, le dimanche de Pâques), au nord comme au sud, manifestant de la sympathie pour le PNV (Parti Nationaliste basque), après avoir lu la thèse de Jean-Claude Larronde : « partie en voiture avec Koldo Zabala et son frère, elle en était revenue très enthousiaste après y avoir vu cette foule immense »... Et elle trouvait Marc Légasse passionnant ! Elle avait également noué amitié avec les deux frères avocats Maurice et Koko Abeberry.
Initiée à la langue basque, elle inscrira à l’ikastola d’Arcangues les deux filles, Maider et Amaia, nées de son mariage avec Georges Hennebutte : ils seront d’ailleurs, tous deux, élus de l’opposition à la mairie de Biarritz, et Maité Maniort-Hennebutte se présentera encore aux élections régionales de 2010 sur la liste régionaliste "Euskadi Europan" de Jean Tellechea.
Avec son mari (notre photo de couverture), elle s’opposera avec succès dans les années 70 au projet de construction d’une marina à la Côte des Basques qui aurait certes défiguré le littoral, mais ne réussira pas à empêcher la destruction de l’hôtel Victoria avec ses jardins descendant sur la Grande Plage et son remplacement par l’immeuble du Victoria-Surf...
Et c’est en 2017, lors d’un entretien avec Terexa Lekumberri enregistré pour le site « Mintzoak » de l’Institut Culturel Basque qu’au qualificatif « Euskalduna » (basque), Maite Maniort-Hennebutte avait ajouté « fededuna » (croyante)...
Le génie créatif et l'humanisme de Georges Hennebutte
À l'occasion de son décès en juin 1999, j'avais rédigé un article sur son mari Georges Hennebutte après avoir rendu visite à Maite Maniort : Georges Hennebutte s'était éteint à 87 ans, entouré de l'affection des siens, son épouse, Me Maite Maniort, et ses deux filles, Maider, avocate comme sa mère et conseillère municipale de Biarritz, et Amaia, enseignante dans une ikastola...
Car par dessus tous ses mérites, avec Maite, il avait su transmettre à ses enfants cet amour du Pays Basque, de Biarritz et des hommes qu'exhalait toujours son incroyable foisonnement d'activités et sa singulière capacité d'invention.


Enfant de l'Atalaye où il avait conservé jusqu'à la fin sa maison familiale "Haïzatua" offerte à tous les vents qui balayent le plateau, les occasions ne lui avaient guère manqué de contempler des naufrages ni d'assister à la noyade de baigneurs souvent ramenés morts sur le sable, car ayant" bu la tasse" d'une manière irrémédiable...
Pour améliorer les conditions de leur sauvetage, il avait inventé une sorte de brancard aquatique qui maintenait au-dessus des vagues les noyés "repêchés" par les sauveteurs et leur évitait d'ingurgiter davantage d'eau de mer pendant qu'ils étaient tirés vers le rivage ; d'abord accroché au maître-nageur, le gilet devenait au contact du noyé un matelas pneumatique muni d'encoches pour s'y accrocher et qui soulevait le baigneur hors des flots, permettant de le ramener sain et sauf sur la plage.
En avait-il fallu des tentatives de persuasion pour faire adopter son projet, dans les années cinquante, jusqu'à ce qu'une démonstration réussie, malgré quelque résistance ultime, n'emporte la décision de la municipalité de Guy Petit ?
Et n'avait-il pas encore mis au point un canot pneumatique à coque rigide, "auto-videur" d'eau au fur et à mesure qu'il "transperçait" les vagues : sur cet "Espadon", il avait même franchi la redoutable barre d'Etel qui avait donné tant de fil à retordre aux hommes de Bombard !
En 1956, et les surfeurs d'aujourd'hui l'ont un peu vite oublié, il les avait précédés en réparant la planche - jusqu'alors inconnue sur nos rivages - de l'acteur et écrivain Peter Viertel, qui l'initia à ce nouveau sport à l'occasion du tournage du film américain « Le soleil se lève aussi » tiré du roman d'Ernest Hemingway. Combien se souviennent encore d'une de ses inventions qui sauva nombre d'entre eux d'un "retour de planche" inopiné et fatal : le "leach" ou cordon en caoutchouc qui la relie désormais au pied du surfeur ?
Car ce "Géo Trouvetout" de génie bénéficiait également de toute l'expérience professionnelle de l'industriel avisé qu'il était, au contact des dernières techniques : n'avait-il pas fabriqué jusqu'en 1991, dans son usine comptant 25 ouvrières, des vêtements anti-atomiques pour l'armée ?
La veine créatrice de l'artiste
Georges Hennebutte savait cependant tempérer cette agitation de tous les instants que lui reconnaissaient ses proches, de la sérénité et - là aussi ! - de la veine créatrice de l'artiste.
Reçu au concours des Beaux-Arts de Paris à l'âge de 17 ans, il avait obtenu pour ses sculptures la Médaille d'Or de l'Exposition Internationale de 1937.
Georges Hennebutte réalisa également la sculpture en creux, sorte "d'anamorphisme en creux", inventa un nouveau procédé pour agencer les éléments des vitraux et peignit de délicats paysages...
Profondément idéaliste, enthousiaste et tenace, rien ne le décourageait. Pas même le désensablement progressif (5 m en 50 ans) d'une des plus belles plages du littoral, disparition à laquelle il ne pouvait se résigner. Aussi avait-il inventé un système pour la réensabler, mais là, son énergie n'avait pas suffi à franchir le mur d'incompréhension qui obère souvent le génie inventif.
Et comme depuis son Atalaye, perdu entre ciel et mer, son regard suit à jamais les reflets du large à l'horizon changeant de l'Océan des Basques...