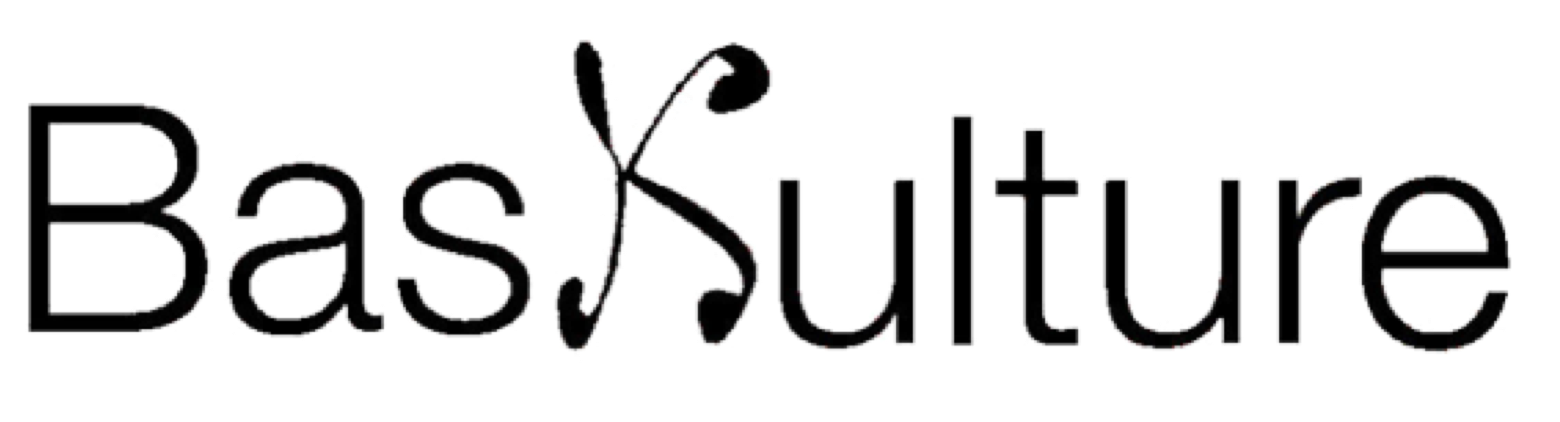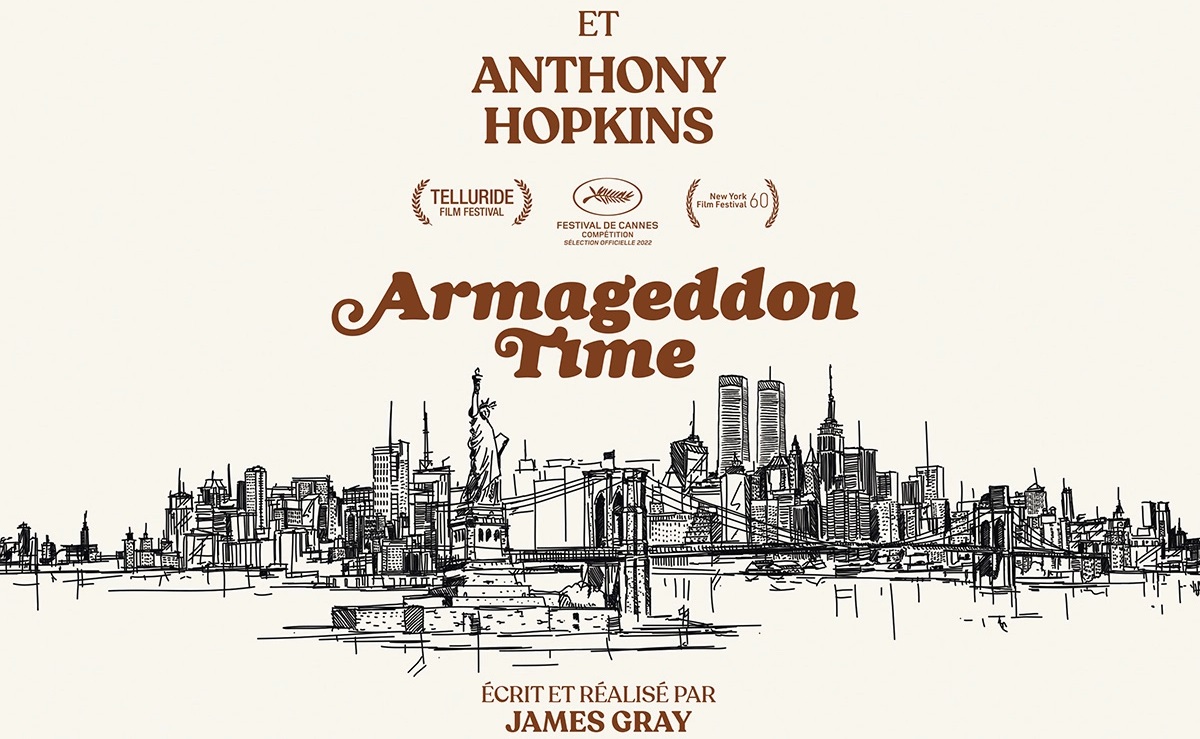Une salle de classe dans une « public school » du Queens (New-York), au début des années 1980. Paul Graff (Michael Banks Repeta), 11 ans, est un adolescent dissipé, turbulent. Pendant les heures de cours il dessine sans cesse : des fusées, des caricatures de son professeur Monsieur Turkeltaub (Andew Polk) dont il déforme le nom, par malice. Dans cette classe, Paul a un grand ami tout aussi chahuteur que lui : Johnny (Jaylin Webb) le seul élève noir de la classe, souffre-douleur de monsieur Turkeltaub. Tous deux sont rebelles à l’ordre établi.
Paul, second fils de la famille Graff, des juifs qui ont anglicisé leur nom, descendants d’émigrés ukrainiens fuyant les pogromes de l’empire tsariste. Il est aimé tendrement par sa mère Esther (Anne Hathaway), mais souvent réprimandé par son père Irving (Jeremy Strong) que son comportement désinvolte agace.
Ce dernier, en dernière extrémité, peut faire acte de violence sur son fils. La famille élargie au grand-père maternel Aaron Rabinowitz (Antony Kopkins), à la grand-mère (Tovah Feldshuh), à la tante Ruth (Marcia Haufrecht) et à l’oncle Louis (Teddy Coluca), dîne comme tous les vendredis chez les Graff.
La tablée est enflammée car les élections présidentielles approchent mettant en concurrence deux candidats au mandat suprême : Ronald Reagan (1911/2004) « un acteur qui jouait avec des chimpanzés » selon le grand-père, et le Président sortant Jimmy Carter (1924).
La télévision montre une interview de Ronald Reagan ou celui-ci pronostique un possible « Armageddon », une guerre nucléaire, une destruction totale de la terre ; le grand père Aaron déclare que Ronald Reagan est un « schmuck » (un débile).
Avec son copain Johnny, Paul fait les 400 coups (il y a des citations du célèbre film de François Truffaut) au grand désespoir de ses parents qui sont intégrés, non sans quelques résistances insidieuses, dans la communauté « wasp » (protestants blancs anglo-saxons) du quartier du Queens. Ces derniers aspirent à une vie américaine « normale » que trouble le comportement asocial de Paul. Le grand père Aaron Rabinowitz le défend, le veille tendrement sur son turbulent petit fils, un futur
« mensh » (un homme vrai) lequel souhaite, selon ses dires, devenir artiste … Pourquoi pas ?
Avec Armageddon Time, son huitième long métrage, James Gray, né à New York en 1969, renoue avec les thèmes majeurs de son œuvre : la famille, son écosystème avec la figure centrale du père. Little Odessa (1994), The Yards (2000), la nuit nous appartient (2007), Two Lovers (2009) déclinent ses obsessions. Armaggedon Time nous est proposé après le brusque virage amorcé par ses deux derniers films : The Lost City of Z sur la recherche d’une civilisation disparue et Ad Astra (2019), enquête d’un spationaute (Brad Pitt) sur son père disparu, mystérieusement, dans l’espace intersidéral.
Son dernier opus dont il a rédigé le scénario, comme à son habitude, est une œuvre automnale (Armageddon Time a été tourné de septembre à octobre 2021), autobiographique pour une grande part, ou un homme de confession juive, non pratiquant, se remémore son passé dans le New-York des années 1980 avec l’élection de Ronald Reagan sur fond de judéophobie, de problèmes de la communauté noire, de perte de l’innocence.
Avec l’élection d’un acteur de second ordre, admirateur de la première ministre anglaise, Margaret Tchatcher (1925/2013), surgit l’avènement du néolibéralisme : une inexorable destruction de l’état (fédéral), une utopie quasi anarchiste, mortifère, sous couvert de « laissez faire, laissez aller ». L’économie brutale prend le pas sur le politique et l’instrumentalise à son seul profit.
Dans cette chronique intime, réminiscence d’un passé à jamais révolu, nous sommes ce que l’enfance nous a fait, James Gray filme avec son soin habituel mais encore plus « resserré » des personnages à jamais disparus : il enregistre des fantômes. Cependant, il nous avertit « ce n’est pas un film nostalgique ».
Son travail sur le passé s’apparente, picturalement, à l’œuvre majeure de Marcel Proust (A la recherche du temps perdu 1906/1922) qu’il cite dans ses interviews sans toutefois avoir la prétention de l’égaler sur le plan cinématographique. Mais comme chez l’écrivain français, il décrit un monde oublié, éphémère : les gens, les lieux, les situations, etc.
A son directeur de la photographie franco-iranien, Darius Khondji, il a déclaré tout à trac, avant le tournage : « nous sommes en train de faire un film de fantômes ». Grâce au travail sur les images (sombres, sans couleurs vives) c’est ce que nous voyons sur l’écran : un cortège de fantômes à jamais disparus qui hante la mémoire de James/Paul.
Armageddon Time a été projeté au dernier festival de Cannes. Il n’a obtenu aucune récompense, alors qu’il méritait, de notre point de vue, la plus haute au regard des autres œuvres en compétition. La finesse, la minutie, de la mise en scène ont dû échapper aux jurés qui ont préféré des films plus tapageurs (Sans filtre, la Palme d’or par exemple).