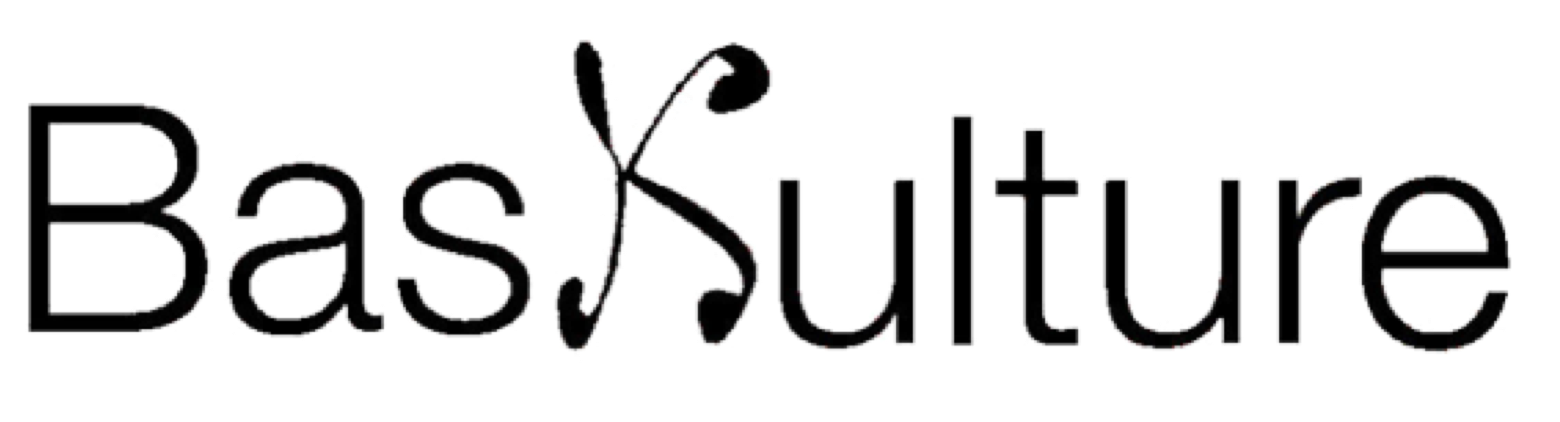Tokyo (anciennement Edo). Fin de l’époque d’Edo (1603/1868), après que l’Empereur Meiji (1852/1912) eut aboli le système féodal. Suite à son bannissement pour un délit qu’il n’a pas commis, le samouraï devenu rônin, Kakunoshin Yanagida (Tsuyoshi Kusanagi), vit difficilement avec sa fille Kinu (Kaya Kiyohara). Pour survivre, il fabrique, avec minutie, des sceaux en pierre lesquels se vendent mal. Sa femme s’est suicidée. Tous ses voisins s’interrogent sur ce rônin digne, taiseux, fréquentant, de temps à autre, quelques gargotes afin d’y défier des joueurs de go. Les règles du go sont simples : c’est un jeu de stratégie ou deux joueurs s’affrontent en posant à tour de rôle sur un plateau quadrillé (goban), les pions noirs ou blancs qu’ils détiennent. Quant la partie se termine le joueur qui occupe la plus grande partie du goban a gagné.
Un jour, Yanagida propose une partie de jeu de go au champion autoproclamé du quartier : Genbei Yorozuka (Jun Kunimura), un commerçant quelque peu roublard. Au moment de gagner la rencontre, contre toute attente, le rônin se retire à la stupéfaction des spectateurs. Plus tard, par ses connaissances en œuvres d’art asiatiques, il rendra service au commerçant.
Genbei invite Yanagida chez lui afin d’y disputer des parties de go qu’il perd systématiquement. Le rônin est imbattable ! Lors d’un des affrontements amicaux dans la demeure du commerçant, une importante somme d’argent disparait. Yanagida est suspecté, ce qui est pour lui insultant : c’est un rônin, un samouraï errant, sans maître mais qui suit à la lettre le bushido, la voie du guerrier, avec son code d’honneur contraignant.
Face à ces accusations, que Yanagida dénie avec force, il songe à se suicider (seppuku) afin de laver son honneur bafoué …
Le Joueur de go est le quinzième long métrage du réalisateur japonais Kazuya Shiraishi (50 ans) mais le premier à être distribué en France : mystère de l’exploitation des films japonais dans notre pays qui a pourtant une appétence remarquée pour les grands maîtres du cinéma japonais depuis la fin de la Deuxième Mondiale. Quelques noms suffisent : Yasujiro Ozu (Printemps tardif – 1949), Kenji Misoguchi (la vie d’Oharu, femme galante – 1952) Akira Kurosawa (Rashomon – 1950, Lion d’or à la Mostra de Venise, et Oscar du meilleur film étranger), Mikio Naruse (Nuages flottants – 1955), Kon Ichikawa (le Pavillon d’or – 1958), Nagisa Oshima (La pendaison – 1968), et tant d’autres. La liste serait impressionnante tant l’art cinématographique a trouvé, depuis le début du XXème siècle, un terreau fertile au pays du soleil levant (l’industrie cinématographique nippone est la quatrième du monde). Le cinéma mondial leur est redevable de la forme épurée, stylisée des images, à laquelle s’ajoutent des histoires fertiles loin des règles hollywoodiennes. Que serait Les Sept Mercenaires (1960) de l’américain John Sturges (1910/1992) sans Les Sept samouraïs (1954) de Akira Kurosawa ou Pour quelques dollars de plus (1964) de l’italien Sergio Leone (1929/1989) sans Yogimbo (1960) du même réalisateur japonais. Les œuvres cinématographiques mondiales seraient à coup sûr différentes.
Le Joueur de go est un film aux images d’une grande beauté tant en décors intérieurs, sombres éclairées par quelques bougies vacillantes, qu’en extérieur jour (étincelant) ou nuit bleutée de pleine lune. Le format écran large (2.39 :1) retenu par le réalisateur et son directeur de la photo Jun Fukumoto sublime les images et les décadrages insolites, surprenants.
Les décors intérieurs minimalistes des habitations japonaises (appartements, boutiques, tripots, etc.) soigneusement reconstitués en studio, sont au service de la dramaturgie : volumes restreints ; portes légères coulissantes ; rare mobilier fonctionnel ; quelques objets décoratifs ; goban du jeu de go, etc. Dans cet univers dépouillé se déploie à la fois la stratégie ludique du jeu de go et la violence latente du samouraï. L’une nourrit l’autre comme deux faces d’une même pièce. Les affrontements peuvent être de go ou de sabre !
Le Joueur de go est une sorte de western non de l’ouest américain mais du soleil levant : un homme injustement accusé fait face à la vindicte publique qui le dénonce comme coupable. Cet homme est un samouraï errant dont les armes sont ses deux sabres (katanas) et non des pistolets : la mort se donne à proximité et non à distance. Par ce simple fait, tout change. A la question d’un journaliste : « Que signifie le jeu de go pour vous ? » Kazuya Shiraishi répond : « Je pense que lorsque vous jouer au go, vous parlez à l’esprit, au caractère et aux sentiments de l’adversaire. Le personnage principal dit qu’il s’en inspire pour mener une existence intègre et juste ».
Le Joueur de go est un film éblouissant car outre sa mise en scène originale, il narre une histoire éternelle de l’homme : son passé, son présent, et la possibilité d’un futur.